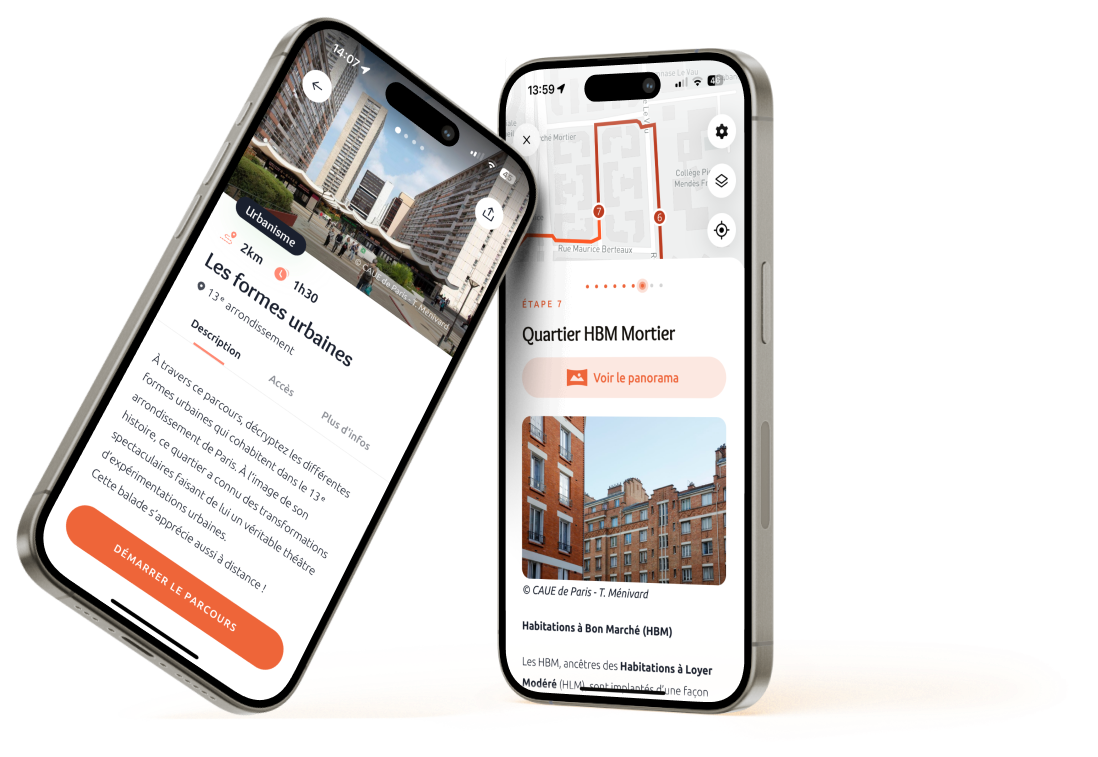La ville royale aux défis de la modernité
Saint-Germain-en-Laye
Saint-Germain-en-Laye est surtout connu pour son château. Du plateau du Bel-Air à la Rampe des Grottes, découvrez un autre visage de la ville à travers le prisme de son développement du XIXème siècle à nos jours ! Photographies et documents d'archives vous présentent une ville en développement où patrimoine et modernité se côtoient.
Ce travail a été réalisé en 2023 par le CAUE 78 en collaboration avec la Ville de Saint-Germain-en-Laye.

Aperçu du parcours
Le plateau du Bel-Air
> Gare Fourqueux - Bel Air
 Vue sur la rue Saint Léger depuis passerelle, 2023 © Martin Argyroglo
Vue sur la rue Saint Léger depuis passerelle, 2023 © Martin Argyroglo
Ce site éloigné du centre-ville a gardé son caractère rural jusqu’au milieu du XXème siècle et a fait l’objet de plusieurs grandes phases d’aménagement. Partez à la découverte de ces différentes étapes !
Une topographie particulière
Le plateau du Bel-Air surplombe une petite vallée façonnée et alimentée par le ru de Buzot. Cette morphologie a favorisé des implantations humaines dès la Préhistoire. Situé en hauteur entre les forêts de Marly et de Saint-Germain, l’air pur lui aurait donné son nom. Jusqu’aux années 1950, le Bel-Air est un quartier éloigné et peu relié au centre-ville. Il est occupé par des habitations, maraîchers et industries.
 Tracé du ru de Buzot au XVIIIème siècle © Carte de Cassini (1756-1789, Géoportail)
Tracé du ru de Buzot au XVIIIème siècle © Carte de Cassini (1756-1789, Géoportail)
Une Z.U.P. sur le plateau
À la fin des années 1950, un grand nombre d’immeubles anciens du centre ville sont insalubres, certains doivent même être détruits. Face à la demande croissante de logements, la ville décide de lancer un projet de ZUP (zone à urbaniser en priorité). Le site choisi se trouve au sud de la ville, où demeurent des espaces libres autour du plateau du Bel-Air.
 La construction de la ZUP © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
La construction de la ZUP © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
Le schéma directeur
Roland Dubrulle, architecte-urbaniste de la ville depuis 1958 réalise un schéma directeur orientant l’implantation des rues, logements et équipements. Le projet n’entraînant pas l’adhésion, l’architecte Pierre Sirvin le remplace en 1968 et propose un nouvel aménagement au dessin plus organique. Il était important que le nouveau quartier vienne se rattacher de manière mesurée sans créer de rupture trop nette, car des maisons individuelles étaient déjà implantées sur le plateau.
 Carte postale du quartier Bel-Air, 1971 © Archives départementales des Yvelines
Carte postale du quartier Bel-Air, 1971 © Archives départementales des Yvelines
Des nouveaux logements de qualité
Près de 4000 logements sont construits : des bâtiments allant du R+2 au R+10, dont la plupart sont à R+6. Les logements sont de grande qualité afin de répondre aux nouveaux standards de confort rendant le quartier attractif pour de jeunes ménages. Tous les appartements sont grands et lumineux avec des cuisines séparées, de nombreux rangements et de larges terrasses. À titre d’exemple, les T1 ont des surfaces de 38 m² ce qui est bien plus que les référentiels actuels.
 Immeuble de logements, place des Rotondes © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
Immeuble de logements, place des Rotondes © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
L’évolution du quartier (1990-2003)
20 ans après la construction de la ZUP, il est décidé de faire à nouveau évoluer le quartier. Les agences Alain Sarfati et Eric Daniel Lacombe sont choisies pour aménager ce site de 4ha avec 54 000m² de surface habitable. Le programme porte sur la construction de 53 logements collectifs, une résidence pour personnes âgées Alzheimer, une résidence étudiante en colocation, un groupe scolaire, une crèche-bibliothèque et l’aménagement des abords de la nouvelle gare Fourqueux - Bel-Air.
 Logements depuis le Mail de l’Aurore, 2023 © Martin Argyroglo
Logements depuis le Mail de l’Aurore, 2023 © Martin Argyroglo
Le plateau du Bel-Air
> Gare Fourqueux - Bel Air
 Vue sur la rue Saint Léger depuis passerelle, 2023 © Martin Argyroglo
Vue sur la rue Saint Léger depuis passerelle, 2023 © Martin Argyroglo
Ce site éloigné du centre-ville a gardé son caractère rural jusqu’au milieu du XXème siècle et a fait l’objet de plusieurs grandes phases d’aménagement. Partez à la découverte de ces différentes étapes !
Une topographie particulière
Le plateau du Bel-Air surplombe une petite vallée façonnée et alimentée par le ru de Buzot. Cette morphologie a favorisé des implantations humaines dès la Préhistoire. Situé en hauteur entre les forêts de Marly et de Saint-Germain, l’air pur lui aurait donné son nom. Jusqu’aux années 1950, le Bel-Air est un quartier éloigné et peu relié au centre-ville. Il est occupé par des habitations, maraîchers et industries.
 Tracé du ru de Buzot au XVIIIème siècle © Carte de Cassini (1756-1789, Géoportail)
Tracé du ru de Buzot au XVIIIème siècle © Carte de Cassini (1756-1789, Géoportail)
Une Z.U.P. sur le plateau
À la fin des années 1950, un grand nombre d’immeubles anciens du centre ville sont insalubres, certains doivent même être détruits. Face à la demande croissante de logements, la ville décide de lancer un projet de ZUP (zone à urbaniser en priorité). Le site choisi se trouve au sud de la ville, où demeurent des espaces libres autour du plateau du Bel-Air.
 La construction de la ZUP © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
La construction de la ZUP © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
Le schéma directeur
Roland Dubrulle, architecte-urbaniste de la ville depuis 1958 réalise un schéma directeur orientant l’implantation des rues, logements et équipements. Le projet n’entraînant pas l’adhésion, l’architecte Pierre Sirvin le remplace en 1968 et propose un nouvel aménagement au dessin plus organique. Il était important que le nouveau quartier vienne se rattacher de manière mesurée sans créer de rupture trop nette, car des maisons individuelles étaient déjà implantées sur le plateau.
 Carte postale du quartier Bel-Air, 1971 © Archives départementales des Yvelines
Carte postale du quartier Bel-Air, 1971 © Archives départementales des Yvelines
Des nouveaux logements de qualité
Près de 4000 logements sont construits : des bâtiments allant du R+2 au R+10, dont la plupart sont à R+6. Les logements sont de grande qualité afin de répondre aux nouveaux standards de confort rendant le quartier attractif pour de jeunes ménages. Tous les appartements sont grands et lumineux avec des cuisines séparées, de nombreux rangements et de larges terrasses. À titre d’exemple, les T1 ont des surfaces de 38 m² ce qui est bien plus que les référentiels actuels.
 Immeuble de logements, place des Rotondes © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
Immeuble de logements, place des Rotondes © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
L’évolution du quartier (1990-2003)
20 ans après la construction de la ZUP, il est décidé de faire à nouveau évoluer le quartier. Les agences Alain Sarfati et Eric Daniel Lacombe sont choisies pour aménager ce site de 4ha avec 54 000m² de surface habitable. Le programme porte sur la construction de 53 logements collectifs, une résidence pour personnes âgées Alzheimer, une résidence étudiante en colocation, un groupe scolaire, une crèche-bibliothèque et l’aménagement des abords de la nouvelle gare Fourqueux - Bel-Air.
 Logements depuis le Mail de l’Aurore, 2023 © Martin Argyroglo
Logements depuis le Mail de l’Aurore, 2023 © Martin Argyroglo
Les Rotondes, une place qui renoue avec son environnement
> La place des Rotondes
 En contrebas de la place, 2023 © Martin Argyroglo
En contrebas de la place, 2023 © Martin Argyroglo
Au centre des immeubles de logement, la dalle du quartier des Coteaux du Bel-Air appartenait à la dernière ZUP construite en France (1966). Découvrez l’évolution de ce quartier auquel la Place des Rotondes a donné un nouveau souffle !
🎧 Écoutez Roger Gicquel, habitant du quartier et figure locale (en haut de page).
L’ancienne dalle des Coteaux du Bel-Air
Vous vous trouvez au centre du quartier, sur l’emplacement de l'ancienne dalle des Coteaux du Bel-Air, typique des aménagements de l'urbanisme des années 1970. Elle accueillait de nombreux commerces et cinq niveaux de parking en sous-sol. Cette vaste esplanade en béton de 5400 m², fréquentée par les habitants des logements qui l’entourent, était en rupture avec son environnement. Dans les années 2000, des réflexions s’engagent pour lui donner un nouvel aspect.
L’ancienne dalle vue depuis le balcon d’un logement © Archives communales de Saint-Germain-en-Laye
Le Bel-Air était constitué de bâtiments d’habitations de grande hauteur et d’un pôle commercial bétonné, fermé sur lui-même, à l’exemple de la modernité des années 1970.
(Hélène Fricout-Cassignol architecte-urbaniste)
Le changement d’image
Dans les années 2000, la Ville constate que le quartier n’a pas une image très positive auprès des habitants. Elle décide en 2008 d’engager la réfection des espaces publics, des équipements : l’ancienne dalle, le groupe scolaire Marie Curie et la démolition-reconstruction du lycée Léonard de Vinci. Toutes ces opérations engagent le quartier dans une démarche de labellisation ÉcoQuartier.
 Sur le toit de l’ancien centre commercial © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye, Jacques Paray (photographe)
Sur le toit de l’ancien centre commercial © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye, Jacques Paray (photographe)
La nouvelle Place des Rotondes
En 2008, l’architecte urbaniste Hélène Fricout-Cassignol est chargée, après concours, du projet de la restructuration de la dalle. Elle crée un nouvel espace public pour “retrouver le ciel, donner des perspectives, laisser la vue ouverte”. La place est articulée autour de deux rotondes, pensées comme des pavillons dans un parc, dont la forme circulaire permet de fluidifier les circulations piétonnes. Un marché forain anime désormais la place une fois par semaine et relie les deux quartiers.
 Le chantier (1976) © Archives communales de Saint-Germain-en-Laye
Le chantier (1976) © Archives communales de Saint-Germain-en-Laye  Le centre commercial (1978) © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
Le centre commercial (1978) © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
 La Place des Rotondes, 2023 © Martin Argyroglo
La Place des Rotondes, 2023 © Martin Argyroglo
Le viaduc, un marqueur dans le paysage
> Viaduc du Val Saint-Léger
 Rampe d'accès au viaduc, 2023 © Martin Argyroglo
Rampe d'accès au viaduc, 2023 © Martin Argyroglo
De sa construction en 1880 à son élargissement en 2003, suivez l’histoire de cet ouvrage d’art indispensable à la connexion du quartier au centre ville.
Le ru de Buzot (dans le Val Saint-Léger)
Cette carte révèle la topographie particulière de la ville marquée par le ru de Buzot. Ce cours d’eau serpente dans le Val Saint-Léger et s’enroule autour du promontoire de Saint-Germain-en-Laye pour rejoindre la Seine.
 Tracé du ru de Buzot © Archives départementales des Yvelines
Tracé du ru de Buzot © Archives départementales des Yvelines
Les tanneries royales vestiges d’un passé artisanal
Au XVIème siècle, de nombreuses activités agricoles et industrielles s’organisent autour du ru avec des moulins et une blanchisserie dont la dernière cheminée a été détruite en 2007. Avis aux curieux, quittez le parcours et marchez jusqu’au 22 rue Schnapper pour découvrir les anciennes tanneries royales témoignant de ce passé artisanal !
 Les anciennes tanneries royales rue Schnapper, 2023 © Martin Argyroglo
Les anciennes tanneries royales rue Schnapper, 2023 © Martin Argyroglo
Un ouvrage pour connecter et franchir
Conçu par les ingénieurs Jacques Arnaud et Charles Geoffroy pour relier la nouvelle gare Grande Ceinture et franchir le ru de Buzot, le viaduc ferroviaire Saint-Léger est achevé en 1880. Les piliers en maçonnerie supportent un tablier métallique en treillis de 311 m de longueur. Des fondations réalisées à l’air comprimé de 25 à 32 m pour chacune des piles permettent de supporter le poids de l’ouvrage.
 Le viaduc en construction © École nationale des ponts et chaussées
Le viaduc en construction © École nationale des ponts et chaussées
Démolition et reconstruction du viaduc
Représentant une infrastructure stratégique, le viaduc est détruit par les Allemands lors de leur retraite en août 1944. Deux ans plus tard, il est entièrement reconstruit avec les matériaux restés sur place. Fruits d’une prouesse technique, les piles en pierre sont restituées avec une largeur de tablier réduite par manque de matériaux. Le viaduc possède ainsi deux voies ferrées en interpénétration, empêchant dès lors le croisement simultané de deux trains.
 Le viaduc après le bombardement © Archives personnelles de M. Gicquel
Le viaduc après le bombardement © Archives personnelles de M. Gicquel
Renforcement des capacités de franchissement
En 2003, parallèlement au réaménagement du quartier du Bel-Air, la gare Fourqueux - Bel-Air est créée et la ligne est enfin électrifiée. De grands travaux sont entrepris pour élargir à nouveau le viaduc et lui adjoindre une passerelle piétonne et cyclable. Comme l’indique la photographie, les anciennes piles ont été consolidées afin de recevoir le nouveau tablier élargi en structure mixte acier-béton. Ces travaux combinés avec l’arrivée du tram en 2022 contribuent à connecter le quartier rénové au centre-ville.
 Les anciennes piles et le nouveau tablier, 2023 © Martin Argyroglo
Les anciennes piles et le nouveau tablier, 2023 © Martin Argyroglo
Sur les traces de la Grande Ceinture
> Le Quai des Possibles
 Façade de la gare Grande Ceinture, 2023 © Martin Argyroglo
Façade de la gare Grande Ceinture, 2023 © Martin Argyroglo
La réouverture et la transformation d’une gare est suffisamment rare pour qu’on s’y intéresse. Derrière cette façade typique de l’architecture de gare du XIXème siècle, se cache aussi une activité inattendue.
La première ligne de transport de voyageurs française
Dès 1832, la Compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain est créée sous l’impulsion des frères Emile et Isaac Pereire. Ils veulent promouvoir le transport de voyageurs par sa fiabilité, sa sécurité et sa ponctualité. En 1847, après la prolongation de la ligne depuis Le Pecq (en chemin de fer atmosphérique pour assurer l’ascension du coteau), une première gare est construite devant le château à l'emplacement d’un des parterres de Le Nôtre. C’est la première ligne de transport de voyageurs de France.
 La gare place du château (1900-1909) © Archives départementales des Yvelines
La gare place du château (1900-1909) © Archives départementales des Yvelines
La Grande Ceinture de Paris
Après la mise en service de la ligne Petite Ceinture de Paris en 1869, une loi (1875) déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer “Grande Ceinture de Paris”. Cette seconde ligne contourne plus largement la capitale à une quinzaine de kilomètres du boulevard périphérique. Sur ce nouveau tracé, la gare Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture est créée pour relier Versailles à Poissy.
 Maillage du territoire par le réseau ferré © Archives départementales des Yvelines
Maillage du territoire par le réseau ferré © Archives départementales des Yvelines
Une architecture de gare emblématique
En 1882, la gare Grande Ceinture est inaugurée. Comme de nombreuses gares de banlieue, le bâtiment répond au modèle standard de l'époque : un édifice symétrique de deux étages surmonté d'une grande horloge. En 1967, restée “dans son jus” elle servira de décor pour la scène finale du film de Louis Malle “Le voleur” dont l'action se déroule à la fin du XIXème siècle.
 La gare Grande Ceinture © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
La gare Grande Ceinture © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
Le réveil d’une belle endormie
La ligne Grande Ceinture est fermée aux voyageurs en 1939, seul le trafic marchandises continue. La gare Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture ferme donc ses portes. Elle est restaurée à l'occasion de la réouverture de la ligne Grande Ceinture Ouest entre Noisy-le-Roi et Saint-Germain-Grande-Ceinture en 2004. En 2014, décision est prise de créer la ligne de tram T13 pour relier Saint-Germain à Saint-Cyr. Inaugurée en 2022, elle rencontre son public et entraîne le développement du nouveau quartier Lisière Pereire, aux abords immédiats de l’ancienne gare.
 Le Quai des Possibles, 2023 © Martin Argyroglo
Le Quai des Possibles, 2023 © Martin Argyroglo
Le Quai des Possibles : “Ceci n’est plus une gare”
Non destinée à accueillir les voyageurs dans le projet de Tram 13, l'ancienne gare devient le Quai des possibles, fruit d'un appel à manifestation d'intérêt (AMI) en 2018. Ce tiers-lieu, dédié à l’économie sociale et solidaire et à l’accompagnement numérique est également un incubateur de projets. Il propose plusieurs espaces (restauration, bien-être, évènements) et impulse une dynamique nouvelle dans le quartier. N’hésitez-pas à pousser la porte de ce lieu sympathique et chaleureux !
La réserve Pereire, une ancienne forêt
 Une villa dans son écrin de verdure, 2023 © Martin Argyroglo
Une villa dans son écrin de verdure, 2023 © Martin Argyroglo
De la lente urbanisation de ce quartier découle une variété de styles architecturaux où brique et meulière dominent. Déambulez au fil des rues et admirez ces grandes maisons construites par des architectes locaux et parisiens.
La Réserve fruit d’une transaction impériale
En 1856, Napoléon III désire relier les anciens terrains de chasse de la forêt de Saint-Germain-en-Laye à ceux de Marly afin de permettre le passage du grand gibier. Cette liaison appelée la Plaine de la Jonction est échangée par l’empereur contre le bois domanial du Vésinet et le Parc de la Réserve à Saint-Germain-en-Laye.
 Plaine de la Jonction et Réserve Pereire © Géoportail / CAUE 78
Plaine de la Jonction et Réserve Pereire © Géoportail / CAUE 78
Le Parc de la Réserve devient constructible
En 1858, la Compagnie Pallu cède les 49 ha de la Réserve à la société des frères Emile et Isaac Pereire. Après défrichage, de nouvelles voies sont créées et la Réserve est lotie comme vous pouvez le voir sur ce plan de 1894. Elle prend le nom de Réserve Pereire.
 Quartier de la Réserve Pereire : plan d'ensemble du lotissement (1894) © Archives communales de Sainte-Germain-en-Laye
Quartier de la Réserve Pereire : plan d'ensemble du lotissement (1894) © Archives communales de Sainte-Germain-en-Laye
Un quartier en attente d’acquéreurs
Malgré la vente de quelques terrains grâce à la proximité de la forêt et du chemin de fer, le quartier tarde à attirer les amateurs de villégiature. En 1896, la caisse des écoles du VIIe arrondissement de Paris décide d’y construire une « Villa Scolaire » à usage de colonie de vacances/sanatorium. Elle est réalisée par Paul Louis Renaud, architecte de l'assistance publique.
 L’ancienne “Villa scolaire”, 2023 © CAUE 78
L’ancienne “Villa scolaire”, 2023 © CAUE 78
Une cité jardin dans un quartier bourgeois
En 1910, le syndicat d'initiative de la Réserve Pereire est fondé pour tenter de séduire de nouveaux acquéreurs. En 1923, il décide d’y construire des logements pour 20 familles nombreuses. Madame Désoyer, épouse du maire de l’époque, fait don d’un terrain à l’office public des H.B.M. (habitations à bon marché) afin qu'une petite cité jardin soit construite par l’architecte Hector Caignard de Mailly au 75 rue Pereire.
 La cité-jardin, 2023 © CAUE 78
La cité-jardin, 2023 © CAUE 78
Un immeuble collectif de style Art Déco
Jusque dans les années 1930, des parcelles continuent à être vendues et divisées. C’est le cas de cet immeuble construit en 1938 au 38 bis rue Pereire dans le jardin d’une ancienne villa. Remarquez les détails typiques du style Art Déco de l’époque : colonnes, cannelures d’inspiration égyptiennes, ouvertures à pans coupés au 2e étage, ferronneries géométriques épurées et toiture terrasse.
 Immeuble années 1930, 38 bis rue Pereire, 2023 © Martin Argyroglo
Immeuble années 1930, 38 bis rue Pereire, 2023 © Martin Argyroglo
L'hôpital, un site en évolution
> Clos Saint-Louis
 Les abords de l'hôpital Saint-Louis, 2023 © Martin Argyroglo
Les abords de l'hôpital Saint-Louis, 2023 © Martin Argyroglo
Signaux dans la ville, ces deux châteaux d’eau marquent le paysage urbain et témoignent d’un passé lié à l’hôpital. Une nouvelle histoire s’écrit pour eux dans ce quartier en mutation !
La construction de l'hôpital
En 1856, il est décidé de reconstruire l'ancien hôpital (place de la Victoire), trop exigu et délabré. Un premier concours lancé en 1870 présidé par les architectes parisiens Emile Vaudremer et Pierre Dubel ne retiendra aucun projet. C’est lors d’un deuxième concours en 1878 que sera retenu le projet d’Alfred Normand grand prix de Rome. Vous pouvez voir l’aspect de l’hôpital sur cette gravure réalisée pour son inauguration en 1882.
 L’hôpital lors de son inauguration en 1882 © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
L’hôpital lors de son inauguration en 1882 © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
Une architecture hygiéniste
Conformément aux théories hygiénistes de l’époque, l’hôpital se développe en quatre pavillons de part et d’autre d’une chapelle centrale. Les bâtiments séparés par des cours sont reliés par de longues galeries largement éclairées. Ces espaces servent à faire entrer un maximum de soleil et à aérer naturellement les salles. Depuis, de nombreuses constructions sont venues compléter le dispositif jusqu’à la saturation du site.
 L’hôpital dans les années 1950 © Archives communales de Saint-Germain-en-Laye
L’hôpital dans les années 1950 © Archives communales de Saint-Germain-en-Laye
La transformation du site
Depuis 2019, après un appel à manifestation d’intérêt et de nombreuses réunions publiques auxquelles près de 2000 habitants ont participé, un projet a été retenu pour la transformation du quartier de l’hôpital. Les agences Bechu & Associés et Atelier Herbez Architectes se chargent du projet de réhabilitation. Une partie du pôle santé est conservée et restructurée afin de permettre la construction de 400 logements et 5000m² de commerces.
 Une des galeries de l’hôpital © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye (photographe Jacques Paray)
Une des galeries de l’hôpital © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye (photographe Jacques Paray)
Place aux piétons !
La transformation du quartier du Clos Saint-Louis rendra accessible aux piétons cette ancienne enclave hospitalière. Autour des bâtiments historiques, 400 logements, dont 70 intermédiaires, seront construits. De grands travaux d'excavation permettront de proposer 1500 places de stationnement souterrains pour limiter la présence de voitures en surface.
 Le chantier de l’hôpital, 2023 © Martin Argyroglo
Le chantier de l’hôpital, 2023 © Martin Argyroglo
Reconversion des châteaux d’eau
Ces deux châteaux d’eau ont été construits au XIXème siècle pour fournir de l’eau sous pression, nécessaire à la ville en cas d’incendie.
 Les châteaux d’eau © Archives communales de Saint-Germain-en-Laye
Les châteaux d’eau © Archives communales de Saint-Germain-en-Laye
Réels repères dans le paysage, les arcs en briques et les balustrades font un clin d'œil au château. Ils sont conservés et intégrés dans le nouveau quartier afin d’y installer un restaurant bar panoramique au sommet et un cinéma en rez-de-chaussée.
 Les châteaux d'eau, 2023 © Martin Argyroglo
Les châteaux d'eau, 2023 © Martin Argyroglo
Le lycée Poquelin dans tous ses états !
 L'entrée du lycée, 2023 © Martin Argyroglo
L'entrée du lycée, 2023 © Martin Argyroglo
Cet établissement scolaire de la fin du XIXème siècle est impressionnant par la répétition des éléments en façade. Mais que se cache-t-il derrière ? Retraçons ici son histoire et sa récente rénovation !
“Un établissement modèle aux portes de Paris”
L'ancien Collège de Saint-Germain-en-Laye, construit en 1897 par l’architecte municipal Henri Choret, est devenu le Lycée Jean-Baptiste Poquelin en 1971. Cet établissement modèle aux portes de Paris, facilement accessible, jouit du grand air et de la proximité de la forêt, il correspond à l'obsession hygiéniste de l'époque.
 Plaquette de promotion © Archives municipales de Saint-Germaine-en-Laye
Plaquette de promotion © Archives municipales de Saint-Germaine-en-Laye
Le collège pour garçons
Ce bâtiment en brique, rationnel, à l’aspect quasi militaire révèle à contrario des salles de classe largement ouvertes sur une cour arborée. Les plans ont été médaillés au salon des artistes français en 1899. En effet, outre les galeries couvertes et l’aération importante, un procédé nouveau dit de lumière diffuse permet d’éclairer les élèves uniformément et d'améliorer leur confort de travail.
 La cour du collège © Archives communales de Saint-Germain-en-Laye
La cour du collège © Archives communales de Saint-Germain-en-Laye
Le collège pour filles
Plus tard, en 1910, le même architecte construit un collège pour filles, à l’extérieur de la ville sur une vaste parcelle. Il applique le règlement en vigueur pour la construction et l’ameublement des collèges et lycées. Les deux constructions diffèrent par leurs contextes et l'expression "genrée" des décors : rationnel pour les garçons, rond et délicat pour les filles.
 Le collège pour filles © CAUE 78
Le collège pour filles © CAUE 78
Une nécessaire réhabilitation énergétique
En 2015, afin de rendre plus fonctionnel le lycée qui ne répond plus aux normes actuelles, la Région décide de réhabiliter et restructurer cet ensemble de 11 000 m², répertorié comme bâtiment remarquable au PLU. Le chantier a permis de restituer le caractère architectural d’origine, caché lors d’une précédente réhabilitation des années 1990.
Le bâtiment avant sa réhabilitation © Philippe Prost : AAPP
Révéler le passé et assumer le présent
L’Atelier d’architecture Philippe Prost, reconnue pour la qualité de ses interventions sur l’existant, a été retenue. Elle a pris le parti de mettre en valeur l’architecture d’origine en révélant au maximum les briques et en signalant les interventions nouvelles par le bois. Les architectes sont intervenus en site occupé et contraint pour ne pas interrompre les enseignements. Le projet a été livré en 2021.
🎧 Écoutez Philipe Prost, architecte-urbaniste, professeur à l'ENSA Paris-Belleville, Grand prix d'architecture en 2022 (en haut de page).
 La nouvelle façade © Luc Boegly
La nouvelle façade © Luc Boegly
Ces photographies avant/après de la rénovation du lycée Poquelin par L’agence d’architecture AAPP vous révèlent la finesse du travail effectué.
 Le préau des années 1990 et après réhabilitation avec ses dispositifs brise soleil © Philippe Prost : AAPP / Luc Boegly
Le préau des années 1990 et après réhabilitation avec ses dispositifs brise soleil © Philippe Prost : AAPP / Luc Boegly
 La coursive avant/après © Philippe Prost : AAPP / Luc Boegly
La coursive avant/après © Philippe Prost : AAPP / Luc Boegly
 L’élévation du plafond permet d’éclairer et de ventiler le couloir © Philippe Prost : AAPP / Luc Boegly
L’élévation du plafond permet d’éclairer et de ventiler le couloir © Philippe Prost : AAPP / Luc Boegly
Une poste pour marquer le centre-ville
> Place du Marché Neuf
 La Poste, place du Marché Neuf © Chini architecte
La Poste, place du Marché Neuf © Chini architecte
Vous voici devant un exemple typique de l’architecture des postes du début du XXème siècle. Découvrez l’histoire de ce bâtiment monumental qui domine la place du Marché Neuf !
Libérer la place du Marché Neuf
Comme le montre cette carte postale de la fin du XIXème siècle, une citerne du réseau de l’aqueduc de Retz occupait une partie de la place. Située devant l’ancienne halle aux grains, elle empêche une lecture claire de l’espace. Afin de donner plus de corps à la place, la citerne et la halle aux grains sont détruites permettant le développement d’un nouveau centre.
 Le réservoir au XIXème siècle © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
Le réservoir au XIXème siècle © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
Une poste qui domine la place
Grâce à une subvention de la commission administrative de l'hôpital, une nouvelle poste est construite en 1911 pour remplacer celle située rue François Bonvin. C’est encore une fois l’architecte municipal Henri Choret qui se charge du projet. Les proportions et le volume du bâtiment permettent de “tenir” la place et d'affirmer son identité.
**  La poste © Archives communales de Saint-Germain-en-Laye
La poste © Archives communales de Saint-Germain-en-Laye
Avec ses façades imposantes au vocabulaire classique, ce bâtiment répond aux critères qui s’appliquent aux postes au début du XXème siècle et inspire un sentiment de confiance à la clientèle. La poste est implantée de manière stratégique en bordure de place et en angle de rue, créant ainsi un point de repère fort dans le paysage urbain. En 2023, des travaux sont entrepris par l’agence d’architecture Chini pour rendre à la façade son aspect d’origine.
 La poste en 1909 © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
La poste en 1909 © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
Le Royal-Palace, un cinéma Art Déco
> Théâtre Jacques Tati
 La façade du théâtre, 2023 © Martin Argyroglo
La façade du théâtre, 2023 © Martin Argyroglo
Avec sa façade en brique, ce bâtiment des années 1930 ne laisse pas indifférent. Remontez le temps grâce aux images d’archives et découvrez ses transformations !
“La plus belle salle de la région”
Au détour de la rue Danès de Montardat, découvrez cet ancien cinéma qui appartenait à l’entreprise Jousseaume, spécialisée dans la projection de films cinématographiques. Il a été construit entre 1928 et 1930 par l’architecte Henri Pierre Jacquelin, qui a également réalisé la salle des fêtes du Pecq en 1934. Voyez sur ce carton d’invitation les ambitions du directeur espérant attirer un public parisien grâce aux omnibus jusqu’à 00h01 !
 Carton de promotion du cinéma © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
Carton de promotion du cinéma © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
La façade années 1930
Vous pouvez voir sur cette façade que l’aspect général du bâtiment a été conservé. Observez les détails caractéristiques du style Art Déco : la géométrie et la composition symétrique de la façade, les références classiques réinterprétées avec les corniches superposées et le fronton, l’usage des pans coupés dans le dessin des ouvertures.
 Le dessin de la façade © Archives communales de Saint-Germain-en-Laye
Le dessin de la façade © Archives communales de Saint-Germain-en-Laye
Changement de décor !
Dans les années 1950, la salle de cinéma est entièrement rénovée et change de style. Sur cette ancienne photographie, remarquez les motifs graphiques, les formes arrondies et les couleurs acidulées qui répondent à la tendance de l’époque. De nouvelles appliques murales en forme de lyre sont installées sur les murs latéraux. Elles sont toujours présentes !
 L’intérieur de l’ancien cinéma © DR La Cinématographie française
L’intérieur de l’ancien cinéma © DR La Cinématographie française
Le saviez-vous ?
En 1970, la ville rachète le cinéma. En 1983, il est entièrement restauré et devient le théâtre Jacques Tati. On l’appelle ainsi, en hommage au célèbre réalisateur ayant vécu rue Voltaire, dans une maison achetée grâce au succès de son film “Mon oncle” !
 Le théâtre Jacques Tati, 2023 © Martin Argyroglo
Le théâtre Jacques Tati, 2023 © Martin Argyroglo
Une architecture contemporaine en site historique
> Médiathèque Marc Ferro
 Le jardin des Arts, 2023 © Martin Argyroglo
Le jardin des Arts, 2023 © Martin Argyroglo
Composant avec nature et patrimoine historique, cet équipement pose avec délicatesse une empreinte contemporaine à deux pas du château. Comment ont procédé les architectes ?
Le Jardin des Arts
Vous vous trouvez actuellement dans le Jardin des Arts, à proximité du château. Entourée d’hôtels particuliers et de maisons de ville, la Villa Eugénie-Désoyer et son jardin appartenaient à l’ancien maire Casimir-Léon Désoyer. En 1929, pour pouvoir y accueillir un musée municipal, le maire lègue la Villa et son jardin à la ville. En 1989, le théâtre Alexandre Dumas y est construit tout en discrétion avec sa salle souterraine atténuant l’impact du bâtiment dans ce secteur sauvegardé. Aujourd’hui, la Villa accueille l’Office du Tourisme Intercommunal, le Café des Arts, l’Apothicairerie Royale et le club Louis-XVI.
Dialogue entre deux époques
En 2005, suite à concours organisé par la ville, les architectes Elizabeth Naud et Luc Poux sont choisis pour leur proposition originale et contemporaine qui dialogue avec l’existant. La toiture en ardoise des bâtiments voisins est réinterprétée par des brise-soleils anthracite intégrés à la façade. Ils permettent un filtrage de la lumière et unifient les deux volumes dont l’un intègre une ancienne façade du XVIIIème siècle.
 La médiathèque depuis la rue Henri IV, 2023 © Martin Argyroglo
La médiathèque depuis la rue Henri IV, 2023 © Martin Argyroglo
Dialogue intérieur / extérieur
Les architectes ont choisi de jouer avec la dualité des deux volumes séparés par une faille taillée dans le verre. Comme deux pavillons dans un jardin, les façades du bâtiment sont sobres et le rythme des percements régulier. Le projet a reçu une mention pour le critère ‘Dialoguer avec le contexte’ au Palmarès 2014 d’architecture, d'urbanisme et de paysage du CAUE 78.
 La faille © Julien Lanoo
La faille © Julien Lanoo
Sur les traces du Château-Neuf
> Rampe des Grottes
 Au bout de la rue Thiers, 2023 © Martin Argyroglo
Au bout de la rue Thiers, 2023 © Martin Argyroglo
Il peut paraître étonnant de conclure ce parcours sur la modernité par le Château-Neuf. Pourtant, cet édifice du XVIème siècle révèle une vision audacieuse de l’aménagement du territoire orienté vers le grand paysage. Partez sur les traces de cette réalisation pharaonique tournée vers la Seine et Paris !
Le Château-Neuf
Postérieur au Château-Vieux, le Château-Neuf affichait quant à lui sa stratégie de “détente”. Situé en point haut de la vallée de la Seine, il dominait et admirait le panorama de l’ouest parisien jusqu’à la Révolution.
 Le Château-Neuf en 1637 par Auguste Alexandre Guillaumot © Gallica / BNF
Le Château-Neuf en 1637 par Auguste Alexandre Guillaumot © Gallica / BNF
La construction du Château-Neuf
En 1557, Philibert Delorme, architecte de Henri II, édifie à proximité du château un bâtiment de plaisance bénéficiant d'une vue magistrale sur l'ouest parisien. Henri IV, en 1594, agrandit ce Château-Neuf pour lui donner une dimension royale aux portes de la capitale. Tournées vers la Seine, deux longues ailes symétriques se terminent par des pavillons-chapelles, l’un de la reine et l’autre du roi. Ce dernier, appelé Pavillon Henri IV, constitue l'un des derniers vestiges encore visibles.
 Le pavillon Henri IV depuis la terrasse du château © CAUE 78
Le pavillon Henri IV depuis la terrasse du château © CAUE 78
La “huitième merveille du monde”
Les coteaux abrupts, sont aménagés par Claude Mollet en jardins d'inspiration italienne qui descendent jusqu'au fleuve. Imaginez, une succession de terrasses, agrémentées de fontaines et de grottes, reliées par des rampes et des escaliers. Murs de soutènement et galeries abritent des grottes richement décorées, animées d’automates hydrauliques. Ces terrasses, accessibles à cheval, permettent en venant de Paris de monter au Château-Neuf. Depuis la vallée, le Château-Neuf apparaît comme une œuvre monumentale dont témoigne encore « le mur des lions ».
 Les châteaux royaux de Saint-Germain-en-Laye © Gallica / BNF
Les châteaux royaux de Saint-Germain-en-Laye © Gallica / BNF
Le Vésinet, en prolongement du Château-Neuf
Vous voyez sur ce plan, le méandre de la boucle du Vésinet-Le Pecq. Face au Château-Neuf, de l’autre côté de la Seine, Henri IV fait ouvrir une longue avenue qui traverse la forêt du Vésinet, l'Avenue Royale. Il reste encore certaines parties visibles (l’avenue qui traverse la Seine dans l’axe, le Tapis Vert et l’Avenue du Grand Veneur en face) d’où se croisent en étoiles d’autres axes rectilignes.
 La boucle du Vésinet-Le Pecq sur le plan de Nicolas de Fer © Gallica / BNF
La boucle du Vésinet-Le Pecq sur le plan de Nicolas de Fer © Gallica / BNF
Face au Château-Neuf, le lotissement du Vésinet
Avec le temps, la forêt, terrain de chasse, se transforme en 1856 en vaste projet de lotissement. Le comte de Choulot et l'architecte Pierre Joseph Olive dessinent le parc du Vésinet. Les anciennes voies de Henri IV sont gardées, mais on leur adjoint un ensemble de routes circulaires. On ménage des pelouses, cinq lacs artificiels où l'on réserve des îles. La villégiature qui s’installe alors bénéficie d’un cadre paysager unique qui conserve encore aujourd’hui l’apparence particulièrement boisée de ses quartiers.
 Projet de colonisation, vue perspective du parc du Vésinet © Gallica / BNF
Projet de colonisation, vue perspective du parc du Vésinet © Gallica / BNF
Le saviez-vous ?
Un ascenseur hydraulique en ciment fut construit à l'occasion de l’exposition universelle de 1900. Il permettait aux piétons et aux cyclistes d'accéder directement du Pecq à la « petite terrasse » de Saint-Germain-en-Laye dessinée par le Nôtre. Il y était relié par une passerelle métallique.
 La passerelle de l’ascenseur et le pavillon Henri IV © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
La passerelle de l’ascenseur et le pavillon Henri IV © Archives municipales de Saint-Germain-en-Laye
D'une hauteur de 35 m, il évitait une montée fastidieuse en pénétrant dans une grotte et sa fontaine artésienne. Son exploitation fut arrêtée en 1921 sans doute par manque d'eau dont la pression lui était indispensable pour faire monter la cabine. Il fût détruit en partie en 1925 mais aujourd’hui encore il subsiste des vestiges.
 L’ascenseur depuis la station inférieure du Pecq © Archives communales de Saint-Germain-en-Laye
L’ascenseur depuis la station inférieure du Pecq © Archives communales de Saint-Germain-en-Laye
En savoir plus sur la Rampe des Grottes : - Ville de saint-Germain-en-Laye, Restauration de la Rampe des Grottes - Un vestige unique du château-neuf (2009-2016) https://www.saintgermainenlaye.fr/ - Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, Le Château-Neuf, la “Huitième merveille du monde” https://musee-archeologienationale.fr - Office de tourisme de Saint-Germain-en-Laye, Le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye. Le projet de restauration de la Rampe des Grottes http://medias.tourism-system.fr
Activités annexes
Accéder au au parcours
 Tramway
Tramway
📍 Fourqueux - Bel Air - Ligne T13
 RER
RER
🏁 Saint-Germain-en-Laye - Ligne A