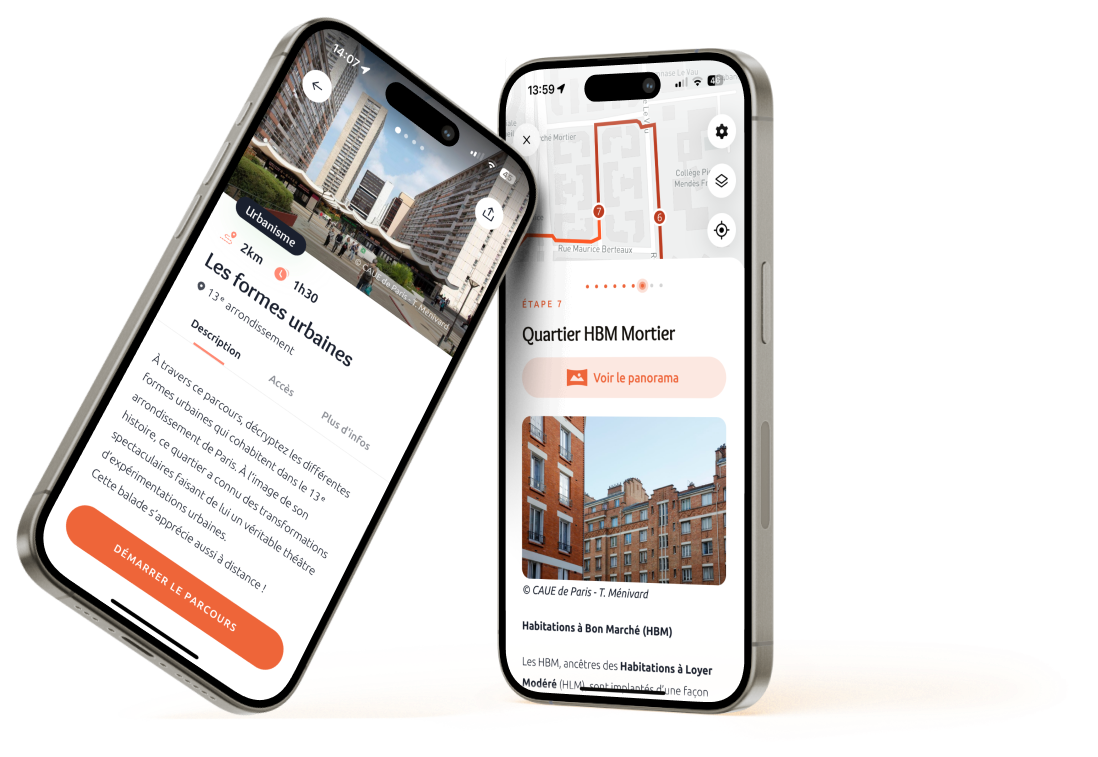Les Mureaux, une ville plurielle
Les Mureaux
À pied ou à vélo, imprégnez-vous des différentes ambiances de la ville des Mureaux. Du renouvellement urbain à la villégiature, remontez le temps grâce à des contributions polyphoniques autour de textes, documents d’archives et vidéos.
Ce travail a été réalisé en 2022 par le CAUE 78 en collaboration avec la ville des Mureaux.

Aperçu du parcours
Les gares au cours du temps
> Gare des Mureaux
 La gare depuis la place du 8 mai 1945, 2022 © Laurent Kruszyk
La gare depuis la place du 8 mai 1945, 2022 © Laurent Kruszyk
L'ancienne gare
 Installation de la voie ferrée parallèlement à la Seine (carte d’état-major 1820-1866) © Géoportail (IGN)
Installation de la voie ferrée parallèlement à la Seine (carte d’état-major 1820-1866) © Géoportail (IGN)
Le village des Mureaux s'étire le long du ru d’Orgeval en direction du fleuve. Il connaît sa première grande transformation en 1843 avec l'arrivée de la première ligne de chemin de fer Paris-Rouen. Son tracé, parallèle au fleuve et à bonne distance de ses berges, passe au sud du bourg historique. Cette infrastructure favorise l’arrivée de citadins en quête de nature et de loisirs liés à l’eau. Un nouveau lieu de villégiature est né !
 L’ancienne gare © Delcampe
L’ancienne gare © Delcampe
La ligne construite en surplomb, coupe la ville en deux. Trois passages sous la voie permettent de relier la ville nord et la ville sud.
 L’hôtel de la gare 1910-1919 © Archives départementales des Yvelines
L’hôtel de la gare 1910-1919 © Archives départementales des Yvelines
Hôtels de voyageurs et restaurants s’implantent autour de la gare. Vous pouvez voir sur cette carte postale un des anciens hôtel-restaurants ayant conservé sa terrasse panoramique avec vue sur la Seine. Rue Gambetta, il est toujours là !
La nouvelle gare
 La nouvelle gare dans les années 1970 © Archives départementales des Yvelines
La nouvelle gare dans les années 1970 © Archives départementales des Yvelines
Une nouvelle gare est construite dans les années 1960 à 150 mètres plus à l’est et au niveau de la rue. Signalée par une toiture triangulaire, elle est, conformément à l'époque, imaginée pour une arrivée en voiture, avec un large espace réservé à la circulation. Elle s’inscrit dans un quartier nouveau de logements collectifs jalonnés par de nombreux parkings.
 La gare et ses abords, 2022 © Laurent Kruszyk
La gare et ses abords, 2022 © Laurent Kruszyk
Réhabilitée dans les années 2000, la gare est habillée de pans de verre toute hauteur et adopte la géométrie qu'on lui connaît aujourd'hui. Avec l’arrivée d’Eole (ligne E du réseau express régional d'Île-de-France), elle se dotera d’une nouvelle image !
Les gares au cours du temps
> Gare des Mureaux
 La gare depuis la place du 8 mai 1945, 2022 © Laurent Kruszyk
La gare depuis la place du 8 mai 1945, 2022 © Laurent Kruszyk
L'ancienne gare
 Installation de la voie ferrée parallèlement à la Seine (carte d’état-major 1820-1866) © Géoportail (IGN)
Installation de la voie ferrée parallèlement à la Seine (carte d’état-major 1820-1866) © Géoportail (IGN)
Le village des Mureaux s'étire le long du ru d’Orgeval en direction du fleuve. Il connaît sa première grande transformation en 1843 avec l'arrivée de la première ligne de chemin de fer Paris-Rouen. Son tracé, parallèle au fleuve et à bonne distance de ses berges, passe au sud du bourg historique. Cette infrastructure favorise l’arrivée de citadins en quête de nature et de loisirs liés à l’eau. Un nouveau lieu de villégiature est né !
 L’ancienne gare © Delcampe
L’ancienne gare © Delcampe
La ligne construite en surplomb, coupe la ville en deux. Trois passages sous la voie permettent de relier la ville nord et la ville sud.
 L’hôtel de la gare 1910-1919 © Archives départementales des Yvelines
L’hôtel de la gare 1910-1919 © Archives départementales des Yvelines
Hôtels de voyageurs et restaurants s’implantent autour de la gare. Vous pouvez voir sur cette carte postale un des anciens hôtel-restaurants ayant conservé sa terrasse panoramique avec vue sur la Seine. Rue Gambetta, il est toujours là !
La nouvelle gare
 La nouvelle gare dans les années 1970 © Archives départementales des Yvelines
La nouvelle gare dans les années 1970 © Archives départementales des Yvelines
Une nouvelle gare est construite dans les années 1960 à 150 mètres plus à l’est et au niveau de la rue. Signalée par une toiture triangulaire, elle est, conformément à l'époque, imaginée pour une arrivée en voiture, avec un large espace réservé à la circulation. Elle s’inscrit dans un quartier nouveau de logements collectifs jalonnés par de nombreux parkings.
 La gare et ses abords, 2022 © Laurent Kruszyk
La gare et ses abords, 2022 © Laurent Kruszyk
Réhabilitée dans les années 2000, la gare est habillée de pans de verre toute hauteur et adopte la géométrie qu'on lui connaît aujourd'hui. Avec l’arrivée d’Eole (ligne E du réseau express régional d'Île-de-France), elle se dotera d’une nouvelle image !
Le renouvellement urbain
> Boulevard Paul Raoult
 Le boulevard Paul Raoult © Atelier JAM architecture territoires
Le boulevard Paul Raoult © Atelier JAM architecture territoires
Le renouvellement urbain est un programme national pour améliorer l’habitat, promouvoir la mixité sociale et stimuler le développement économique afin de revaloriser l’image des quartiers.
Un projet urbain sur l’ensemble de la ville
 Schéma de cohérence urbaine des Mureaux, janvier 2019 © Atelier JAM architecture territoires
Schéma de cohérence urbaine des Mureaux, janvier 2019 © Atelier JAM architecture territoires
Depuis 2001, la continuité de la municipalité en place a permis d’engager un projet urbain sur l’ensemble de la ville. La révision des documents d'urbanisme a permis de fixer et de tenir un cadre réglementaire au renouvellement urbain. Les enjeux portent sur la pérennité des équipements, la diversité de l’offre de logements et la construction écologique appliquée aux projets communaux et privés.
Vers la ville parc
 L’écoquartier Molière avec les “pistons” © Atelier JAM architecture territoires
L’écoquartier Molière avec les “pistons” © Atelier JAM architecture territoires
Conçu par l’Atelier JAM, architectes urbanistes, ce projet global est l’un des plus importants de France. Concernant 15 000 habitants (près de la moitié de la ville), il se traduit par des transformations majeures : reconversion de l’autoroute urbaine en boulevard planté, désenclavement des quartiers avec parcs et espaces paysagers. En 20 ans, la ville des Mureaux est devenue plus verte !
 L’autoroute urbaine, fin des années 1990 et en 2019 © Ville des Mureaux
L’autoroute urbaine, fin des années 1990 et en 2019 © Ville des Mureaux
Accompagnant la construction de nouveaux immeubles de logements, le plan d’ensemble organise des continuités végétales entre l’avenue Paul Raoult et le quartier de Bècheville. Ces espaces végétalisés, appelés “pistons”, invitent les habitants à se déplacer à pied ou à vélo d’un quartier à l’autre de manière apaisée.
 Un “piston” © Atelier JAM architecture territoires
Un “piston” © Atelier JAM architecture territoires
Pour découvrir ces pistons, quittez le boulevard et montez en direction du château de Bècheville !
Vers une planification écologique
> Parc de Bècheville
 Façade arrière du château, 2022 © Laurent Kruszyk
Façade arrière du château, 2022 © Laurent Kruszyk
La construction du château : la maison des champs devient château
 Le plan d’eau devant le château, début XXème siècle © Delcampe
Le plan d’eau devant le château, début XXème siècle © Delcampe
En 1811, le domaine de Bècheville a été acquis par Pierre Daru, intendant général de la grande armée. Au milieu du XIXème, son fils Napoléon Daru, construit à la place de la rustique “maison des champs”, un château dans le goût du Second Empire. Il se caractérise par un mélange de styles (antiquité, renaissance, ancien régime). Un parc boisé à l’anglaise, qui couvrait initialement 22 hectares, accompagne le château.
Une architecture au goût de l’époque
 Vue frontale de la façade arrière du château, 2022 © Laurent Kruszyk
Vue frontale de la façade arrière du château, 2022 © Laurent Kruszyk
L’architecte du château, Henri Parent, dans le bon goût de l’époque, pastiche une architecture du XVIIe siècle. Le style Second Empire se traduit ici par une haute toiture en ardoise, une profusion de cheminées, de fenêtres, une symétrie de la façade et un parement de briques et de pierres de taille.
Une décoration éclectique
 La fresque pompéienne, 2022 © CAUE 78
La fresque pompéienne, 2022 © CAUE 78
Aujourd’hui, on peut encore observer la décoration intérieure de style Empire, traduisant un certain goût pour l’éclectisme. Ce décor composite mêle boiseries XVIIIe siècle, cheminée Empire et peintures néo-classiques inspirées des fresques de Pompéi.
Du château à l’école de musique
 L’école Paul Raoult derrière le château © Ville des Mureaux
L’école Paul Raoult derrière le château © Ville des Mureaux
Dans les années 1950, la ville, suite à l’agrandissement de l’usine Renault à Flins passe de 5000 à 22 000 habitants. Pour accueillir les enfants des nouveaux habitants, la ville rachète le château et le transforme en école. Rapidement les effectifs dépassant sa capacité d’accueil, l’école Paul Raoult est construite à l’arrière du château. Depuis 1977, le château est occupé par l’école de musique, actuel conservatoire Gabriel Fauré.
Le jardin à l’anglaise : une imitation de la nature
L’ancienne glacière © Ville des Mureaux
Conçu à l’origine comme un jardin à l’anglaise, le parc conserve des chemins sinueux qui offrent différents points de vue et ambiances. Il possède une partie boisée, une prairie, une roseraie et une rocaille. Sur la gauche du château, la glacière permettait de conserver des aliments et de la glace. À l’arrière, l’école Paul Raoult contrarie la perspective initiale vers le château.
Vers un parc écologique
 Concertation auprès des habitants pour un parc écologique, 2021 © CAUE 78
Concertation auprès des habitants pour un parc écologique, 2021 © CAUE 78
Une concertation sur le parc a été entrepris avec la ville, les habitants et le CAUE 78*, pour répondre aux usages des habitants tout en respectant le dessin historique et les enjeux climatiques. L’ambition est de faire de ce parc « urbain atypique » un lieu d’exception où la biodiversité se conjugue avec les activités humaines quotidiennes.
*Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l‘environnement des Yvelines
Le Pôle éducatif Molière, un projet durable
 L'entrée du pôle Molière,2022 © Laurent Kruszyk
L'entrée du pôle Molière,2022 © Laurent Kruszyk
Le Pôle Molière met en scène la topographie du coteau et les espaces communs aux équipements socioculturels, scolaires et de la petite enfance.
Un équipement pour tous
 L’ancienne tour Molière © Collection Renaud Epstein
L’ancienne tour Molière © Collection Renaud Epstein
Le pôle Molière est situé à la place de l'ancienne tour de logements du même nom, dynamitée en 2010. Cet équipement conçu par AKLA (Malene Kristensen, Hervé Levaseux architectes) est innovant par son programme et son architecture. Il abrite dans un même îlot des activités éducatives et sociales (crèche, écoles, associations, équipements sportifs). L’accueil des enfants du personnel, des parents et des riverains dans les espaces mutualisés favorise le lien social !
“Ce sera un pôle unique en France. Je veux un lieu de mixité, un lieu de rencontre, un lieu de brassage des communautés, un endroit où la danse africaine côtoie la danse classique.”
(François Garay, Le Parisien, vendredi 1er octobre 2010)
 L’implantation du projet dans la pente © Atelier JAM architecture territoires
L’implantation du projet dans la pente © Atelier JAM architecture territoires
Le projet architectural en bois et béton, implanté sur un terrain à forte déclivité, offre des vues sur le paysage. On y circule par une alternance de terrasses, de balcons, de placettes, de gradins et de rampes ouverts sur les espaces publics avoisinants.
 Une vue intérieure du pôle Molière,2022 © Laurent Kruszyk
Une vue intérieure du pôle Molière,2022 © Laurent Kruszyk
Conformément au souhait de la Ville, ce bâtiment à énergie positive (BEPOS), produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.
 Vue sur panneaux photovoltaïques et les toitures végétalisées © AKLA
Vue sur panneaux photovoltaïques et les toitures végétalisées © AKLA
Pour parvenir à cette équation, 450m2 de panneaux photovoltaïques et de toitures végétalisées sont nécessaires. De plus, ses besoins en chauffage sont très faibles grâce à une isolation renforcée et une ventilation double-flux.
Une signalétique originale
La signalétique de Malte Martin © CAUE 78
Une signalétique du designer Malte Martin permet une identification ludique de chaque lieu et activité. Elle a été co-construite avec les utilisateurs et financée dans le cadre du 1% artistique. Le cercle jaune pour la crèche, le carré rouge pour la maternelle et le triangle bleu pour l’école primaire.
Une gestion de l’eau pédagogique
 Noue et plantations pour la récupération de l’eau, 2022 © Laurent Kruszyk
Noue et plantations pour la récupération de l’eau, 2022 © Laurent Kruszyk
Le chemin de l’eau est mis en scène et souligne la composition en terrasses. Les noues, barbacanes et caniveaux à ciel ouvert contribuent à la gestion durable des eaux pluviales et participent à une pédagogie du vivant. Ces espaces en partie végétalisés constituent des niches pour la biodiversité urbaine.
Visitez cet équipement. Il a reçu plusieurs prix pour ses qualités environnementales !
Le Parc Molière
Une noue du Parc Molière, 2022 © CAUE 78
Le Parc Molière, agréable espace de promenade, relie certains lieux emblématiques de la ville.
 Tracé du Ru sur la carte d’Etat Major © Atelier JAM architecture territoires
Tracé du Ru sur la carte d’Etat Major © Atelier JAM architecture territoires
Le Parc Molière est un espace vert de 7,5 hectares traversé par le ru d’Orgeval. Ce petit affluent prend sa source à Orgeval et rejoint la Seine aux Mureaux. Le ru, canalisé au moment de l’urbanisation des années 1950-1960, a été redécouvert et constitue le fil conducteur du dessin du parc.
Le ru d’Orgeval redécouvert © Atelier JAM architecture territoires
De forme libre et conçu comme une promenade, il se démarque des parcs historiques bien dessinés et délimités. Corridor écologique, il se déroule et relie différentes pièces végétales de la ville. Profitez des différentes activités de loisirs, aires de jeux et installations sportives. Essayez les tables de pique-nique géantes et leurs barbecues !
 Photographie aérienne avant / après © Ville des Mureaux
Photographie aérienne avant / après © Ville des Mureaux
Le renouvellement urbain des Mureaux s’est accompagné d’une réflexion sur les modes de déplacement à pied et à vélo. Profitez-en, pour utiliser le large réseau de pistes cyclables de la ville et prolonger la visite !
Un grand ensemble de Charles Gustave Stoskopf
> La Vigne Blanche
 Les balcons colorés typiques des logements de Stoskopf, 2022 © Laurent Kruszyk
Les balcons colorés typiques des logements de Stoskopf, 2022 © Laurent Kruszyk
À la fin des années 50, suite au succès de la “Dauphine”, l’usine Renault de Flins Aubergenville s’est agrandie. Aux Mureaux, site stratégique desservi par une gare, l'Etat décide, en discussion avec Paul Raoult maire de l’époque, d’implanter 1000 logements dont 600 seront destinés aux ouvriers de l’usine.
 La Vigne Blanche © Delcampe
La Vigne Blanche © Delcampe
L’architecte Charles Gustave Stoskopf est connu pour la conception de grands ensembles en France et dans les Yvelines (Poissy et Vernouillet). Pour répondre à la demande, il utilise le procédé du “béton caverneux”, matériau moins dense permettant d’accélérer le temps de séchage et de construction. Une église et un centre social accompagnent les logements.
 Le grand ensemble © Collection Renaud Epstein
Le grand ensemble © Collection Renaud Epstein
Un site religieux historique
> Eglise Notre-Dame-des-Neiges
 L’entrée de l’église et sa mosaïque, 2022 © Laurent Kruszyk
L’entrée de l’église et sa mosaïque, 2022 © Laurent Kruszyk
Difficile d’imaginer qu’un monastère bénédictin occupait ce site.
Une première chapelle du même nom aurait été fondée par les Bénédictins au XIIIème siècle et aurait disparue fin XVIIIème. En lieu et place, l’église, réalisée par les architectes Charles Gustave Stoskopf et André Biro, participe au grand ensemble. Elle est inaugurée à Noël 1960.
 Les vitraux en damier et la toiture pliée, 1969 © Archives départementales des Yvelines
Les vitraux en damier et la toiture pliée, 1969 © Archives départementales des Yvelines
Une église gymnase !
Remarquez cette architecture étonnante construite en béton et coiffée d’une toiture métallique en forme de pliage ! Halle monolithique, métal et béton caverneux répondent aux conditions budgétaires modestes. Pensée comme une “église-équipement” elle peut accueillir d’autres usages. Derrière une apparente austérité, des variations de vitraux animent différemment chaque façade.
 L’intérieur de l’église et la structure métallique © Laurent Kruszyk
L’intérieur de l’église et la structure métallique © Laurent Kruszyk
Vestiges et nouveaux usages
> Ateliers du Moulin
 Entrée des Ateliers du Moulin © Cécile Septet Photographe
Entrée des Ateliers du Moulin © Cécile Septet Photographe
Attardez-vous sur cet ensemble du XVIIIème siècle, vestige du patrimoine rural dans ce quartier des années 1960.
Un moulin à l’abandon
 L’ancien moulin avant l’intervention des architectes, années 2000 © Think Tank architecture paysage urbanisme
L’ancien moulin avant l’intervention des architectes, années 2000 © Think Tank architecture paysage urbanisme
Idéalement placé contre le ru d’Orgeval, cet ensemble comprenait un moulin à eau, une grange et une bergerie qui a fait office de presbytère.
 Confrontation entre les vestiges du passé et le grand ensemble, années 1960 © Delcampe
Confrontation entre les vestiges du passé et le grand ensemble, années 1960 © Delcampe
Une nouvelle vie
En 2015, l’agence THINK TANK architecture gagne le concours pour la réhabilitation de l’ancien moulin en lieu de pratique artistique. Cette intervention respectueuse du bâti d’origine a restauré la maçonnerie en révélant les lits de pierre, les baies ogivales et les contreforts, témoins du passé.
 Les Ateliers du Moulin depuis la rue Molière © Cécile Septet Photographe
Les Ateliers du Moulin depuis la rue Molière © Cécile Septet Photographe
“Dès le démarrage de l’opération, nous avons également proposé de renommer les lieux pour que démarre l’appropriation du projet par chacun. Plus personne ne savait nommer ce lieu ni les différents bâtiments. La toponymie est le premier outil possible de transformation d’un lieu et de son histoire.”
(Think Tank Architectes)
 Espace d’exposition dans la Grange © Cécile Septet Photographe
Espace d’exposition dans la Grange © Cécile Septet Photographe
Les Ateliers du Moulin accueillent les artistes en résidence. Le hall principal du bâtiment peut se transformer en lieu d’exposition et ateliers. L’ancienne Grange, au niveau inférieur, se compose de salles destinées à des ateliers éphémères. La Bergerie, plus isolée, est dédiée au stockage de matériel.
 Aménagements liés à la pente © Cécile Septet Photographe
Aménagements liés à la pente © Cécile Septet Photographe
Le Moulin, la Grange et la Bergerie sont situés à des niveaux différents. Ils sont reliés par un grand emmarchement composé d’escaliers, de gradins et d’espaces plantés.
L'axe historique dévoyé
> Rue Aristide Briand
 Rue Paul Doumer, 2022 © Laurent Kruszyk
Rue Paul Doumer, 2022 © Laurent Kruszyk
La rue Aristide Briand / Paul Doumer était l’axe historique menant des Mureaux à Meulan par le franchissement du pont de Meulan aujourd’hui disparu.
 La rue Aristide Briand, 2022 © Laurent Kruszyk
La rue Aristide Briand, 2022 © Laurent Kruszyk
Témoignages de villégiature
 Villa, 2022 © Laurent Kruszyk
Villa, 2022 © Laurent Kruszyk
La rue Aristide Briand, ancienne voie historique d’entrée de ville, a perdu sa vitalité à la suite du percement de l’avenue Paul Raoult (RD43) et de la construction du nouveau Pont Rhin-et-Danube. Un grand nombre d’éléments patrimoniaux atteste de l’importance de cette rue qui comporte des maisons de bourgs, de notables, des immeubles et des villas remarquables.
 Une ancienne enseigne commerciale restaurée, 2022 © Laurent Kruszyk
Une ancienne enseigne commerciale restaurée, 2022 © Laurent Kruszyk
Empruntez le tunnel ferroviaire, non loin de la gare, et prêtez attention aux immeubles de deux étages ou plus, situés dans l’ancienne Grande rue. L’un d’entre eux a conservé une belle modénature et ses peintures publicitaires ont été restaurées. Une carte postale ancienne montre à quoi ressemblait ce beau bâtiment qui abritait alors l’hôtel de Paris.
 La rue commerçante pendant les Trente Glorieuses © Delcampe
La rue commerçante pendant les Trente Glorieuses © Delcampe
Suite à l’essor de l’industrie automobile, à l’implantation de Renault à Flins-Aubergenville, plusieurs grands ensembles ont été construits pour loger les ouvriers de l’industrie. La circulation de la rue Aristide Briand, lisible sur la carte postale, témoigne de l’activité florissante de la ville lors des Trente Glorieuses.
 © 1. Archives Départementales des Yvelines / 2. et 3. Géoportail (IGN)
© 1. Archives Départementales des Yvelines / 2. et 3. Géoportail (IGN)
- Cadastre napoléonien (1821) : Le village s’étire du sud au nord le long du ru d’Orgeval.
- Carte topographique de Paris et ses environs (1999) : La ville s’étire le long de la route conduisant au pont de Meulan.
- Photo aérienne (2021) : Avec le nouveau Pont Rhin-et-Danube et l’avenue Paul Raoult, l’axe de circulation historique est dévoyé.
La place de la Libération
 Le dessin des sols, 2022 © Laurent Kruszyk
Le dessin des sols, 2022 © Laurent Kruszyk
En parallèle du projet, les espaces publics autour de la Mairie ont été réaménagés. Par le traitement des sols et les plantations de cyprès, la place de la Libération donne la priorité aux piétons et met en valeur la mairie d’origine et l’église.
L'église saint-Pierre Saint-Paul
L’église Saint-Pierre Saint-Paul succède à une ancienne église de la fin du XVIème qui était située sur l’actuelle place de la Libération contre l’axe historique Paul Doumer.
 L’église, la rue et son lavoir © Archives départementales des Yvelines
L’église, la rue et son lavoir © Archives départementales des Yvelines
L’emplacement libéré par l’ancienne église a permis d’installer la mairie et de créer la place de la Libération. La nouvelle église a été construite au bout de la rue Carnot en 1894 par les architectes Roussel et Forichon dans le style néo-gothique dont le clocher haut est caractéristique.
Réemploi des chapiteaux de l’église © CAUE 78
Ouvrez l'œil, et retrouvez sur le parcours (rue de la Haye), des chapiteaux et colonnes de l’ancienne église qui ont été réemployés sur les portails de certaines villas !
L'ancienne mairie
> Pôle administratif
 L’ancienne mairie, 2022 © CAUE 78
L’ancienne mairie, 2022 © CAUE 78
Découvrez les différentes transformations apportées à la mairie au fil du temps.
 La mairie (première moitié du XXème siècle) © Delcampe
La mairie (première moitié du XXème siècle) © Delcampe
Si l’on compare la carte postale de l’ancienne mairie (1925), avec le bâtiment actuel, on remarque que seul le balcon du premier étage a été conservé, l’enduit et le reste des décors ont disparu.
 L’ancien mur en moellons dans la nouvelle mairie © CAUE 78
L’ancien mur en moellons dans la nouvelle mairie © CAUE 78
Le nouveau pôle administratif laisse apparaître des réminiscences du passé à l’intérieur, comme les murs de pierre donnant sur la salle des mariages dont la décoration a été conservée.
 L'entrée du pôle administratif, 2022 © Laurent Kruszyk
L'entrée du pôle administratif, 2022 © Laurent Kruszyk
Pour la municipalité élue en 2001, plusieurs raisons ont présidé au choix d’agrandir l’hôtel de ville : donner une nouvelle image, construire un équipement écologique, rationaliser et concentrer les services éclatés sur 21 sites.
Une vitrine écologique
 Le raccordement entre ancienne et nouvelle mairie, 2022 © CAUE 78
Le raccordement entre ancienne et nouvelle mairie, 2022 © CAUE 78
Lauréats du concours, l'équipe d'architectes Hesters et Barlatier a répondu aux objectifs de conservation de la mairie existante et de construction écologique. L’ancienne mairie abrite la salle du conseil et la salle des mariages dans l’axe de la grande place de la libération. La nouvelle aile du pôle administratif, par son architecture répétitive, traduit la rationalité de l’équipement avec bureaux et salles de réunions au service des administrés.
 Volets et brise soleil, 2022 © Laurent Kruszyk
Volets et brise soleil, 2022 © Laurent Kruszyk
Inauguré en 2005, ce bâtiment vitrine pour la commune est le premier certifié HQE (Haute qualité environnementale) pour le tertiaire. Les innovations techniques mises en œuvre sont organisées en 5 axes majeurs : le confort d’été, la gestion de l’eau, le renouvellement de l’air, le confort d’hiver et l’énergie solaire. La lumière naturelle a été privilégiée pour les circulations intérieures grâce à d’abondants vitrages.
 Toiture végétalisée © Hesters et Barlatier
Toiture végétalisée © Hesters et Barlatier
Depuis sa mise en service, pour évaluer la performance réelle des équipements, le bâtiment fait l’objet d’un suivi précis des consommations d’électricité et de la quantité d’eau de pluie récupérée sur la terrasse haute. Les bilans permettent d’observer les évolutions annuelles des consommations. Un exemple à suivre !
Perle de l’industrie à la Belle Époque
> Papèterie Pont-de-Claix
 La papeterie des Mureaux vue depuis la rue de La Haye © Région Île-de-France, Phot. Laurent Kruszyk, 2022.
La papeterie des Mureaux vue depuis la rue de La Haye © Région Île-de-France, Phot. Laurent Kruszyk, 2022.
La parole au chercheur Nicolas Pierrot :
Cette usine remarquable, construite par les Papeteries du Pont-de-Claix, témoigne d’une phase décisive de la conquête industrielle dans la vallée de la Seine francilienne, à la veille de la Première Guerre mondiale.
 La salle d’apprêt et de triage du papier, vue depuis le bâtiment de direction et de logement © Région Île-de-France, Phot. Laurent Kruszyk, 2022.
La salle d’apprêt et de triage du papier, vue depuis le bâtiment de direction et de logement © Région Île-de-France, Phot. Laurent Kruszyk, 2022.
Entre le port du Havre et le marché parisien
Pourquoi les Papeteries du Pont-de-Claix (Isère) choisissent-elles de s’installer aux Mureaux en 1911 ? Les papeteries alpines vivent alors leur « âge d’or », mais s’installer en val de Seine leur permet de s’approvisionner en pâtes scandinaves par Le Havre et de se rapprocher du marché parisien. L’usine couvrait quatre hectares et employait une centaine d’ouvriers. Elle fabriquait des papiers fins et mi-fins pour l’impression et l’écriture.
 Le bâtiment de la turbine vu depuis la rue de la Motte © Région Île-de-France, Phot. Laurent Kruszyk, 2022.
Le bâtiment de la turbine vu depuis la rue de la Motte © Région Île-de-France, Phot. Laurent Kruszyk, 2022.
Vapeur et électricité : l’âge d’or des centrales d’usines
L’usine, construite en « U », abrite une chaîne opératoire sans rupture : stockage des pâtes, piles raffineuses, machine à papier, apprêt et tri du papier, magasin. L’énergie était fournie par une centrale associant génératrice et turbine à vapeur. Construit en maçonnerie de meulière comme l’ensemble de l’usine, le bâtiment de la turbine se distingue par ses larges baies cintrées. Il est caractéristique de l’industrie française avant son raccordement aux grandes centrales thermiques.
 La papeterie Braunstein, puis site Dunlop © Fonds Bertin, AM Mantes-la-Jolie.
La papeterie Braunstein, puis site Dunlop © Fonds Bertin, AM Mantes-la-Jolie.
Les trois perles de la vallée à la Belle Époque de l’industrie
Entre la confluence de l’Oise et la Normandie, la papeterie des Mureaux se distingue comme l’une des trois usines-symboles de la seconde industrialisation dans la vallée de la Seine, avec l’usine de papier à cigarettes Braunstein de Mantes-la-Jolie, construite à partir de 1891 (Dunlop en 1950) et l’ancienne usine de la société Le Camphre.
 L’usine du Camphre, puis site Singer © Région Île-de-France, Phot. Laurent Kruszyk, 2012.
L’usine du Camphre, puis site Singer © Région Île-de-France, Phot. Laurent Kruszyk, 2012.
À Bonnières, l’ancienne usine de la société Le Camphre construite en 1907, puis usine Singer en 1933, est célèbre pour ses machines à vapeur Farcot de 1906 et 1907.
Villégiature en bord de Seine
> Villa de l'Oseraie
 La façade sur jardin, 2022 © CAUE 78
La façade sur jardin, 2022 © CAUE 78
🎥 Cliquez ici pour visualiser une séquence vidéo historique de la Villa de l'Oseraie.
La parole à la chercheuse Roselyne Bussière :
Au XIXe siècle, le bourg des Mureaux, placé en bord de Seine et facile d’accès, attire des Parisiens en quête de bon air et de sports nautiques.
La façade sur jardin © Région Île-de-France, Phot. Laurent Kruszyk, 2016
Au XIXe siècle, le bourg des Mureaux, placé en bord de Seine et facile d’accès, attire des Parisiens en quête de bon air et de sports nautiques.
 Les façades © Encyclopédie d’architecture, 1879
Les façades © Encyclopédie d’architecture, 1879
La maison d’un « grand amateur de navigation fluviale »
Construite et publiée en 1879 par l’architecte Jules Saulnier, la villa répond à un programme bien précis : « elle devait être située près de la Seine, en bordure du chemin de halage sur lequel devait s’ouvrir une remise pour les bateaux faisant partie d’un sous-sol […] qui devait être assez élevé pour être à l’abri des inondations. » ainsi qu’il l’écrit dans l’Encyclopédie d’Architecture.
 Plan du rez-de-chaussée © Encyclopédie d’architecture, 1879
Plan du rez-de-chaussée © Encyclopédie d’architecture, 1879
Une maison pour recevoir ses amis
Le rez-de-chaussée, très articulé, accorde la plus belle place au salon (E) ouvert sur le fleuve par une triple baie. La salle à manger (F), est en retrait, pour laisser place à une grande terrasse abritée des vents d’ouest. Un office (H) placé avant la cuisine (D) témoigne de l’organisation de la maisonnée autour d’une domesticité logée dans trois chambres au second étage. On y trouve aussi trois chambres d’ami.
 La façade sud © Encyclopédie d’architecture, 1879. Détail © Région Île-de-France, Phot. Laurent Kruszyk, 2016
La façade sud © Encyclopédie d’architecture, 1879. Détail © Région Île-de-France, Phot. Laurent Kruszyk, 2016
Une architecture de la brique
L’œuvre majeure de l’architecte Jules Saulnier (1817-1881) est le moulin construit à Noisiel (77) pour l’industriel chocolatier Emile Menier en 1872-74.
 Façade du Moulin Saulnier à Noisiel (77) © Inventaire général, Phot.Philippe Fortin, 1991
Façade du Moulin Saulnier à Noisiel (77) © Inventaire général, Phot.Philippe Fortin, 1991
En 1860, c’est en pan-de-bois et brique que Saulnier avait construit l’atelier du peintre Rosa-Bonheur à Thomery.
 Atelier de Rosa-Bonheur Thomery (77), détail © Région Île-de-France, Phot. Philippe Ayrault, 2019
Atelier de Rosa-Bonheur Thomery (77), détail © Région Île-de-France, Phot. Philippe Ayrault, 2019
La disparition du pont
> Quartier de la Sangle
 Bords de Seine, 2022 © Laurent Kruszyk
Bords de Seine, 2022 © Laurent Kruszyk
Après la destruction du pont en 1944, la construction du pont Rhin-et-Danube en aval du précédent a profondément bouleversé le quartier de la Sangle.
 L'axe de l'ancien pont, 2022 © Laurent Kruszyk
L'axe de l'ancien pont, 2022 © Laurent Kruszyk
Vers 1820, le village des Mureaux s’étirait le long de la route conduisant au pont de Meulan, parallèlement au ru d’Orgeval dont la confluence avec la Seine est matérialisée par le hameau de la Sangle. Ce dernier, tête du pont de Meulan, était alors rattaché à Meulan.
 Cadastre napoléonien (1821) © Archives Départementales des Yvelines
Cadastre napoléonien (1821) © Archives Départementales des Yvelines
Un grand vide
Le quartier de la Sangle est marqué par de nombreuses disparitions laissant un grand vide. L’empreinte de la confluence avec le ru d’Orgeval reste encore perceptible dans le vaste espace ouvert reliant la ville à la Vallée de la Seine et à l’air du large. Dans le lointain, émerge de la ripisylve la silhouette industrielle d’EADS.
 Le tête de l’ancien pont et la confluence du ru d’Orgeval busé, 2022 © Laurent Kruszyk
Le tête de l’ancien pont et la confluence du ru d’Orgeval busé, 2022 © Laurent Kruszyk
Les ports des Mureaux
Dès l’Antiquité la ville des Mureaux était dotée d’un port. Elle était établie, comme Meulan, à l’intersection du fleuve et d’une voie antique venant d’Orléans, traditionnellement appelée la “chaussée Brunehaut” et qui franchissait le fleuve sur des ponts de bois probablement au niveau de la rue des Gros-murs. La carte postale ancienne montre une survivance de l’activité portuaire à proximité du grand pont.
 L’ancien port © Geneanet
L’ancien port © Geneanet
Déjeuner en bord de Seine
L’arrivée de la ligne de chemin de fer Paris-Rouen, inaugurée en 1843, accélère le développement de la villégiature. L’avenue de la gare mène à des établissements de villégiature en bord de Seine. La carte postale ancienne montre une scène de déjeuner ombragé depuis la terrasse de l’Hôtel-Restaurant Esther, donnant sur les arches du Grand Pont, et Meulan dans le lointain sur la rive opposée.
 Déjeuner en bord de Seine, Hôtel - Restaurant Esther © Archives Départementales des Yvelines
Déjeuner en bord de Seine, Hôtel - Restaurant Esther © Archives Départementales des Yvelines
Baignade entre amis
La villégiature c’est le “repos oisif à la campagne” en accueillant ses amis. Ces bains de Seine illustrent parfaitement les divertissements offerts par la proximité du fleuve. La baignade de Seine est une activité rafraîchissante dont on parle beaucoup aujourd'hui !
🎥 Cliquez ici pour visualiser une séquence vidéo historique de bains de Seine.
Les berges de Seine et le nautisme
> Cercle de voile
 Le Cercle de voile de Paris, 2022 © Laurent Kruszyk
Le Cercle de voile de Paris, 2022 © Laurent Kruszyk
Vous voici face à l’un des plus anciens clubs de voile français. D’illustres personnalités s’y retrouvaient pour le loisir et la compétition. Fin 2024, ces bâtiments du XIXème siècle ont été retenus par La Fondation du patrimoine afin d'être restaurés dans leur ensemble.
 Coursive et terrasse du club de voile, 2022 ©Laurent Kruszyk
Coursive et terrasse du club de voile, 2022 ©Laurent Kruszyk
Histoire et évolution du cercle de voile de Paris
À sa fondation en 1858, l’un des plus anciens yachts-clubs français, le Cercle de la Voile de Paris (CVP), s’installe au Petit-Gennevilliers (92). Il est fréquenté par les peintres impressionnistes, Claude Monet et Gustave Caillebotte. En 1893, suite à la construction de la première ligne de chemin de fer entre Paris et Saint-Germain-en-Laye, qui coupe le plan d’eau en deux, le CVP déménage aux Mureaux.
 Le club-house à son origine © Delcampe
Le club-house à son origine © Delcampe
Le saviez-vous ?
Gustave Caillebotte était féru de régates. Meilleur barreur de son temps, il a remporté de nombreux prix en France. Il est nommé vice-président du Cercle de la Voile de Paris en 1880. Fasciné par la technologie et la vitesse, c’est un architecte naval de renommée mondiale, notamment pour ses plans de yachts performants et élégants.
 Le Roastbeef, dessiné en 1891 et construit par G. Caillebotte en 1892 © Sequana
Le Roastbeef, dessiné en 1891 et construit par G. Caillebotte en 1892 © Sequana
Les JO de 1924
En 1924, le CVP est chargé d’organiser l’épreuve de voile en solitaire des Jeux Olympiques. Il fournira l’ensemble des équipes olympiques de voile françaises aux JO de 1932 et de 1936. Au courant du XXème siècle, plus d’une cinquantaine de membres ont représenté la voile française aux JO. « Bien naviguer, viser l’excellence mais aussi s’amuser et retrouver ses amis au club-house après la régate » font partie des devises.
 La stèle des JO de 1924, 2022 © Laurent Kruszyk
La stèle des JO de 1924, 2022 © Laurent Kruszyk
Une école du courant hygiéniste
> École Roux Calmettes
 Fronton de l’école, 2022 © Laurent Kruszyk
Fronton de l’école, 2022 © Laurent Kruszyk
Cette école fait partie des équipements construits à la fin du XIXème. Elle répond aux critères du mouvement hygiéniste avec ses grandes salles de classe, ses larges fenêtres et ses espaces de jeux.
 Pendant le chantier © Ville des Mureaux
Pendant le chantier © Ville des Mureaux
Aux Mureaux, la plupart des équipements témoignent des préoccupations de leur époque. Dans les années trente, l'architecte yvelinois André Ribault, pour répondre à un besoin urgent de place, construit une nouvelle école sur un grand terrain libre. La première pierre de l'école est posée le 8 octobre 1932. Bombardée en mai 1944, l'école sera reconstruite puis agrandie en 1948.
 La cour et les grandes baies vitrées des salles de classe © Ville des Mureaux
La cour et les grandes baies vitrées des salles de classe © Ville des Mureaux
Émile Roux et Albert Calmette. Ce dernier a participé à la découverte du vaccin BCG contre la tuberculose. La cour de grande longueur est bordée sur un seul côté par un long bâtiment orienté plein Sud. Il accueille toutes les classes, hautes sous plafond, et équipées de grandes baies vitrées très lumineuses. Cette architecture s’apparente à celle des sanatoriums.
 Entrée de l’école, 2022 © CAUE 78
Entrée de l’école, 2022 © CAUE 78
L’architecte a proposé une implantation très aérée où l'air et la lumière doivent circuler abondamment. Remarquez le jardin de représentation qui conduit à l’entrée principale.
Façade d’entrée, 2022 © Laurent Kruszyk
Le porche principal coiffé d’un pignon en gradins est agrémenté d'une horloge. Des inscriptions en ferronnerie sur la porte et sur le fronton rappellent la fonction de l’édifice et les fondements de la laïcité.
 Dessin de la façade, 2022 © Laurent Kruszyk
Dessin de la façade, 2022 © Laurent Kruszyk
La combinaison des formes orthogonales et des formes arrondies est représentative du style des années 1930. La brique est le matériau privilégié, répondant à l’obligation faite aux architectes de concevoir des façades durables et d’un entretien facile. En façade, brique et meulière sont associées élégamment en créant un jeu de textures et de couleurs. Admirez l’agencement de ces différents motifs !
 Les façades restaurées en meulière, 2022 © Laurent Kruszyk
Les façades restaurées en meulière, 2022 © Laurent Kruszyk
En 2018, la labellisation Patrimoine d'intérêt régional a permis de financer en partie les travaux de restauration sur les façades en meulière. Elles n’avaient fait l’objet d’aucune intervention depuis 1948.
Découvrez l'intérieur de cette école ou le temps semble s'être arrêté :
 Une décoration soignée, 2022 © Laurent Kruszyk
Une décoration soignée, 2022 © Laurent Kruszyk
 Une salle de classe lumineuse, 2022 © Laurent Kruszyk
Une salle de classe lumineuse, 2022 © Laurent Kruszyk
 Un revêtement esthétique et fonctionnel, 2022 © Laurent Kruszyk
Un revêtement esthétique et fonctionnel, 2022 © Laurent Kruszyk