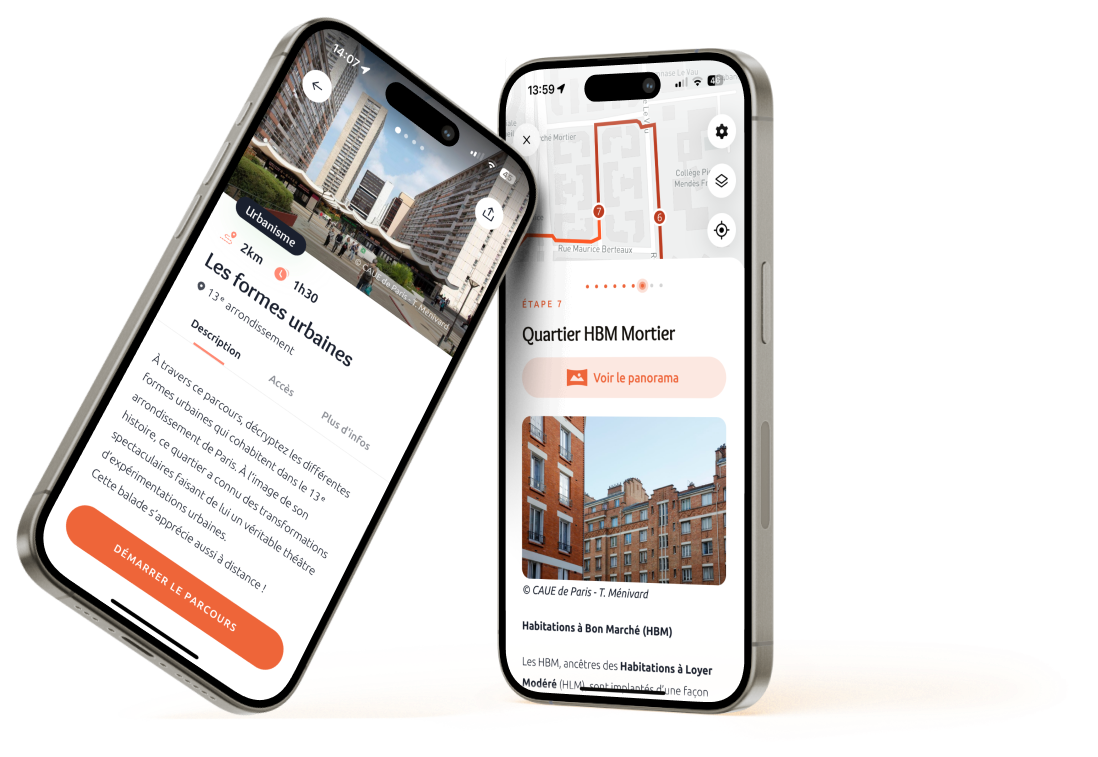À la confluence de la Marne et de la Seine, transformation d
Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine




Autour de la confluence entre la Seine et la Marne, découvrez les vestiges d’un passé industriel foisonnant, les mutations accompagnant le développement métropolitain du secteur, la réhabilitation de bâtiments patrimoniaux et quelques réalisations contemporaines.
Parcours conçu par le CAUE du Val-de-Marne.
Aperçu du parcours
Les écoles du centre

L’école Aristide Briand a fait l’objet d’une succession de remaniements architecturaux qui lui confèrent un caractère inédit.
 © Archives Municipales de Charenton-le-Pont
© Archives Municipales de Charenton-le-Pont
La municipalité de Charenton-le-Pont fait construire, en 1865, les « Écoles du Centre », un groupe scolaire de 16 classes sur un terrain de 3 000 m².
L’école initiale, construite par Claude Naissant, est un bâtiment de style classique composé de deux étages surmontés d’une toiture à deux pans et de façades en pierre et en briques percées de baies en plein-cintre.
 Agrandissement des écoles du centre en 1893 par l'architecte Georges Guyon © Archives Départementales du Val-de-Marne
Agrandissement des écoles du centre en 1893 par l'architecte Georges Guyon © Archives Départementales du Val-de-Marne
 Plan de façade, école Aristide Briand, Eugène Descombes, 1951 © Archives Municipales de Charenton-le-Pont
Plan de façade, école Aristide Briand, Eugène Descombes, 1951 © Archives Municipales de Charenton-le-Pont
Les « Écoles du Centre » furent par la suite remaniées par Henri Guyon et Eugène Descombes.
Le bâtiment central est également surélevé d’un étage et les constructions sont couvertes d’une terrasse aménagée, afin de doubler la surface de la cour du rez-de-chaussée.
Henri Guyon transforme alors le clocheton ajouté par son père en un moderne et impressionnant beffroi.
 L'école en 1960 © Archives Municipales de Charenton-le-Pont
L'école en 1960 © Archives Municipales de Charenton-le-Pont
Les façades sont également transformées pour répondre aux critères de l’architecture moderne : casquettes en béton, composition géométrique et rationnelle, absence d’ornements décoratifs.
Dans un souci d’hygiénisme, préoccupation grandissante à cette époque, les baies sont agrandies afin de faire entrer davantage d’air et de lumière.
À la fois sévères et solides, les façades de l’école rappellent aussi la grandeur de la République.
© CAUE 94
Les écoles et la place sont renommées Aristide Briand. En 1932, à l’arrière du site, en bordure du bois de Vincennes, est construite l’extension de l’École de préapprentissage pour filles. C’est également Henri Guyon qui dessine ce projet, dans un style Art Déco.
Le bâtiment a fait l’objet d’une réhabilitation pour y aménager des logements.
Les écoles du centre

L’école Aristide Briand a fait l’objet d’une succession de remaniements architecturaux qui lui confèrent un caractère inédit.
 © Archives Municipales de Charenton-le-Pont
© Archives Municipales de Charenton-le-Pont
La municipalité de Charenton-le-Pont fait construire, en 1865, les « Écoles du Centre », un groupe scolaire de 16 classes sur un terrain de 3 000 m².
L’école initiale, construite par Claude Naissant, est un bâtiment de style classique composé de deux étages surmontés d’une toiture à deux pans et de façades en pierre et en briques percées de baies en plein-cintre.
 Agrandissement des écoles du centre en 1893 par l'architecte Georges Guyon © Archives Départementales du Val-de-Marne
Agrandissement des écoles du centre en 1893 par l'architecte Georges Guyon © Archives Départementales du Val-de-Marne
 Plan de façade, école Aristide Briand, Eugène Descombes, 1951 © Archives Municipales de Charenton-le-Pont
Plan de façade, école Aristide Briand, Eugène Descombes, 1951 © Archives Municipales de Charenton-le-Pont
Les « Écoles du Centre » furent par la suite remaniées par Henri Guyon et Eugène Descombes.
Le bâtiment central est également surélevé d’un étage et les constructions sont couvertes d’une terrasse aménagée, afin de doubler la surface de la cour du rez-de-chaussée.
Henri Guyon transforme alors le clocheton ajouté par son père en un moderne et impressionnant beffroi.
 L'école en 1960 © Archives Municipales de Charenton-le-Pont
L'école en 1960 © Archives Municipales de Charenton-le-Pont
Les façades sont également transformées pour répondre aux critères de l’architecture moderne : casquettes en béton, composition géométrique et rationnelle, absence d’ornements décoratifs.
Dans un souci d’hygiénisme, préoccupation grandissante à cette époque, les baies sont agrandies afin de faire entrer davantage d’air et de lumière.
À la fois sévères et solides, les façades de l’école rappellent aussi la grandeur de la République.
© CAUE 94
Les écoles et la place sont renommées Aristide Briand. En 1932, à l’arrière du site, en bordure du bois de Vincennes, est construite l’extension de l’École de préapprentissage pour filles. C’est également Henri Guyon qui dessine ce projet, dans un style Art Déco.
Le bâtiment a fait l’objet d’une réhabilitation pour y aménager des logements.
Le lycée Robert Schuman
 © Epicuria Architecture, photographe Nicolas Borel
© Epicuria Architecture, photographe Nicolas Borel
Sur un site à forte contrainte urbaine, l’Agence d’architecture Epicuria a conçu un projet de qualité, en apportant une réflexion sur le confort des usagers mais également sur la préservation des ressources.
 Plan masse du lycée © Epicuria Architecture
Plan masse du lycée © Epicuria Architecture
Livré en 2009, ce lycée d’enseignement général et technologique tertiaire pour 710 élèves comprend également 5 logements de fonction.
Située sur le site d’une ancienne carrière, la parcelle triangulaire de 8 000 m² est enclavée au milieu d’autoroute, de voie ferrée et d’habitat résidentiel.
 Cour intérieure du lycée © Epicuria Architecture, photographe Nicolas Borel
Cour intérieure du lycée © Epicuria Architecture, photographe Nicolas Borel
Le bâtiment triangulaire suit les contours parcellaires et se développe autour d’une cour intérieure. La forme du bâtiment permet de protéger le cœur de la parcelle des nuisances sonores. Les façades extérieures accueillent les circulations et les locaux techniques, alors que les façades côté cour accueillent les salles d’enseignement.
 Double peau © Epicuria Architecture, photographe Nicolas Borel
Double peau © Epicuria Architecture, photographe Nicolas Borel
Les façades extérieures doublées par deux parois en verre (appelé double peau) offrent à la fois une protection sonore au bâtiment tout en lui offrant des vues sur son environnement ainsi qu’un apport de lumière naturelle pour limiter les besoins en éclairage artificiel.
La recherche d’une architecture performante et responsable
Construction du puits canadien © Epicuria Architecture
Un puits canadien de grande dimension situé sous la cour, utilise l’inertie thermique de la terre pour rafraichir ou préchauffer l’air extérieur ensuite insufflé dans le bâtiment.
Le béton choisi pour être le système constructif de ce bâtiment offre des réponses structurelle, thermique, acoustique et esthétique dans sa construction. La recherche d’une isolation performante pour augmenter le confort des usagers est également recherché.
 Schéma des principes HQE utilisés au sein du bâtiment © Epicuria Architecture
Schéma des principes HQE utilisés au sein du bâtiment © Epicuria Architecture
200 m² de panneaux solaires thermiques sont installés en toiture pour préchauffer l’eau chaude des sanitaires alors que des piles photovoltaïques produisent de l’électricité revendue. Dans un souci esthétique pour les riverains. les toitures sont également recouvertes de végétation permettant en outre de parfaire l’isolation du bâtiment.
La collecte des eaux de pluie sont utilisées dans les toilettes du RDC, pour l’arrosage des espaces verts du site et l’entretien du bâtiment.
L'ancienne île Martinet
 © Archives Départementales du Val-de-Marne
© Archives Départementales du Val-de-Marne
Cette bande de terre, appelée l’île Martinet, était anciennement séparée de la commune de Charenton-le-Pont par le canal de Saint-Maurice.
 Photographie aérienne de 1950 © Institut Géographique National
Photographie aérienne de 1950 © Institut Géographique National
Creusé en 1864, le canal permet l’acheminement de marchandises par bateaux vers la capitale.
Il relie l’écluse de Gravelle, en aval du confluent avec la Seine, et le pont de Charenton en amont.
 Photographie aérienne de 1972 © Institut Géographique National
Photographie aérienne de 1972 © Institut Géographique National
Il est comblé en 1950 pour permettre l’établissement de la route nationale 4 qui deviendra l’autoroute A4 en 1974.
Le Gymnase Tony Parker
 © Basselier Jarzaguet Architectes, Deprick et Maniaque Architectes, Photo Daniel Moulinet
© Basselier Jarzaguet Architectes, Deprick et Maniaque Architectes, Photo Daniel Moulinet
Bâtiment contemporain aux façades discrètes, le gymnase Tony Parker livré en 2010 et conçu par Basselier Jarzaguet architecte, se déploie élégamment le long de la Marne.
 vue intérieure © Basselier Jarzaguet Architectes, Deprick et Maniaque Architectes, Photos Daniel Moulinet
vue intérieure © Basselier Jarzaguet Architectes, Deprick et Maniaque Architectes, Photos Daniel Moulinet
Pour ce projet de réhabilitation-extension, l’ancien gymnase est revêtu d’une nouvelle façade et un second gymnase est créé. Celui-ci est composé d’une structure en acier galvanisé rappelant l’existant. L’ensemble comprend alors deux terrains séparés par des parois de polycarbonate translucide laissant apparaître la structure métallique.
Les reflets et ondulations que produisent les parois font écho aux reflets de l’eau en contre-bas.
 © Basselier Jarzaguet Architectes, Deprick et Maniaque Architectes
© Basselier Jarzaguet Architectes, Deprick et Maniaque Architectes
Un bâtiment à l’entrée forme un socle et ancre les deux gymnases.
Les gymnases sont dédiés à divers pratiques sportives comme le basket, le handball, le volley-ball et l’escalade. Le projet abrite également une salle de musculation, des bureaux pour les associations sportives, des salles de réunions, huit vestiaires ainsi que deux logements de fonction.
Les Quais vers 1900
 © Martin Argyroglo
© Martin Argyroglo
Autour de la confluence entre la Seine et la Marne, découvrez les vestiges d’un passé industriel foisonnant.
 © Archives Municipales d’Ivry-sur-Seine
© Archives Municipales d’Ivry-sur-Seine
Connectant le trafic fluvial de la Seine au réseau ferroviaire de la Compagnie d'Orléans par l'intermédiaire de la gare d'Ivry, le port d’Ivry constitue au début du XXᵉ siècle un lieu industriel d’intérêt local et national. Il permet à la ville de connaître un important développement économique.
 DR
DR
L’ « Entrepôt d’Ivry » occupe un terrain de trois hectares. Il sert à l’approvisionnement de Paris et de la banlieue. Y transitent charbon de bois de la Nièvre, charbon de terre du Pas-de-Calais, de Belgique et d’Angleterre, bois du Morvan, pommes de terre de Bourgogne et de l’Orléanais, eaux minérales, vins de France et d’Algérie, bières d’Ivry-sur-Seine, etc.
 © Archives Départementales du Val-de-Marne
© Archives Départementales du Val-de-Marne
À Charenton-le-Pont, le quai des Carrières, qui doit son nom à l’activité d’extraction de sable qui occupe les berges, et dénommé un temps quai de la Gare, est aménagé en 1863.
Diverses marchandises sont stockées le long des berges dont notamment du bois de chauffe.
Les « Bateaux Parisiens »
Jusque dans les années 1930, le trafic des « bateaux parisiens » anime également le site.
 © Archives municipales, ville d'Alfortville
© Archives municipales, ville d'Alfortville
À partir de 1880, une ligne de transport fluviale relie alors le viaduc d’Auteuil à Charenton-le- Pont où sont arrimés quatre pontons sur la rive droite de la Marne. Des arrêts sont également implantés à Alfortville et Ivry-sur-Seine. En contrebas des quais entre Alfortville et Charenton-le-Pont stationnaient alors des débarcadères flottants.
 © musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine.
© musée de la batellerie et des voies navigables, Conflans-Sainte-Honorine.
Le trafic est quasiment continu, des bateaux se succédant toutes les 10 minutes entre 5 heures du matin et 8 heures du soir.
Interrompu en 1917, le service réouvre en 1921. Enfin, par décision du conseil général de la Seine, il est finalement définitivement arrêté en 1934 et supplanté par le métropolitain et le tramway parisien.
L’école Pierre Bérégovoy
 © Chabanne – Guillaume Guérin
© Chabanne – Guillaume Guérin
Monolithe de béton blanc livré en 2015 par l’agence Chabanne Architecte, l’école se veut être un cocon protecteur pour ses 600 élèves.
Le bâti s’implante en périphérie de la parcelle pour libérer le maximum d’espace au cœur de l’école, et ainsi constituer un filtre contre les nuisances (vent du Nord, bruit venant du quai d’Alfortville, et plus loin de l’autoroute et de la voie de chemin de fer).
 © Chabanne – Guillaume Guérin
© Chabanne – Guillaume Guérin
Les strates du bâtiment permettent d’articuler une cour basse à vocation sportive et une cour haute avec des ateliers ludiques.
 © Chabanne – Guillaume Guérin
© Chabanne – Guillaume Guérin
Le projet développe une démarche environnementale : murs à ossature bois, toiture végétalisée, digesteur réduisant les volumes de déchets issus de la cuisine, pompe à chaleur sur nappe phréatique permettant d’utiliser le potentiel géothermique du site et de réduire les émissions de CO2, production photovoltaïque (150m²).
Logements en bords de Marne
 ANMA Architectes Urbanistes © Sergio Grazia
ANMA Architectes Urbanistes © Sergio Grazia
Livrés en 2013 les logements construits par ANMA, s’inspirent d’un langage industriel revisité et proposent un ensemble résolument contemporain et urbain.
 ANMA Architectes Urbanistes © Sergio Grazia
ANMA Architectes Urbanistes © Sergio Grazia
Les toitures sheds, équipés de panneaux solaires, et la fragmentation des façades à redents alternant enduit coloré, failles vitrées et bardage métallique dessine une architecture dynamique et singulière.
À travers les percées visuelles aménagées, un jardin se laisse entrevoir au centre de la parcelle.
 ANMA Architectes Urbanistes © Sergio Grazia
ANMA Architectes Urbanistes © Sergio Grazia
Chinagora
 ©Martin Argyroglo
©Martin Argyroglo
Emblématique et insolite, Chinagora surplombe la pointe de la Confluence depuis son inauguration par Michel Rocard, ancien premier ministre, et l’Ambassadeur de Chine, en 1992.
 © Ville d'Alfortville, direction de la Communication, Germain Lefranc (10/07/2019)
© Ville d'Alfortville, direction de la Communication, Germain Lefranc (10/07/2019)
Ce centre d’échanges économiques, technologiques et culturels franco-chinois est construit dans le cadre des grands chantiers d’aménagement de l’Île-de-France à la suite de la création de la ZAC du Confluent en 1986.
 extrait de la brochure de présentation Chinagora, 1992, centre d'échanges économiques et technologiques France-Chine © Archives Municipales d'Alfortville
extrait de la brochure de présentation Chinagora, 1992, centre d'échanges économiques et technologiques France-Chine © Archives Municipales d'Alfortville
Ce complexe de 50 000 m² comprend un hôtel de 200 chambres, une galerie commerciale de 4000 m², un espace d’exposition, un jardin intérieur et un restaurant panoramique.
Cet ensemble immense et étonnant est construit dans le style mandchou suivant les plans de l'architecte chinois Liang Kunhao.
 © Archives Municipales d'Alfortville
© Archives Municipales d'Alfortville
Faute de fréquentation, le palais des expositions ferme dès 1995. La fermeture de la galerie marchande suivra ensuite en 1997.
En 2012, le groupe Chinois Huatian reprend le fonds de commerce et rénove l’hôtel, le restaurant, et aménage des salles de séminaire.
Les jardin seront quant à eux rénovés en 2016.
Avant la construction de Chinagora, l’usine Chelle occupait le site.
 Usine Chelle vue aérienne vers 1937
Usine Chelle vue aérienne vers 1937
© Cahiers de l'Inventaire n°12, Architectures d'usine en Val de Marne (1822-1939), Ministère de la Culture et de la communication, Inventaire général des richesses artistiques de la France, Région Paris/Ile-de-France, Conseil régional, 1988
La Compagnie Française d’Embouteillage y fait construire, en 1934, un ensemble comprenant plusieurs bâtiments dont un édifice de style paquebot à la pointe du quai.
Le traitement de l’angle en arrondi, les toits terrasses superposés et la rangée de hublots rappellent le pont d’un bateau.
La société est dissoute au début des années 1980 et le bâtiment détruit en 1987.
Un site en devenir
La situation stratégique de tête de proue de la Confluence attise intérêt et imagination.
Lors de la Consultation internationale sur le Grand Pari(s), quatre équipes d’architectes ont fait des propositions de scénarii possibles.
A ce jour, aucun des projets ne s’est concrétisé.
L'ancienne usine élévatoire des eaux
 ©Martin Argyroglo
©Martin Argyroglo
Baptisée « Ivry 1 », cette ancienne usine élévatoire de la ville de Pari est la première d’une série d’usines destinées à alimenter en eau la capitale.
Construite entre 1881 et 1883, elle set à puiser l’eau de la Seine et à l’acheminer jusqu’au réservoir de Villejuif.
 © Archives Départementales du Val-de-Marne
© Archives Départementales du Val-de-Marne
Projet établi par l’ingénieur Adolphe Alphand en 1879, les deux halles accolées abritent six machines à vapeur Farco de 50 chevaux chacune et sont capables de refouler 85 000 m³ d’eau en 24 heures à une hauteur de 63 mètres.
En 1898, trois nouvelles machines de 170 chevaux sont ajoutées portant alors la longueur du bâtiment à environ 80 mètres. Chaque baie correspond, en effet, à une machine.
 Plan de coupe © Archives de Paris - cote 1Fi 1570
Plan de coupe © Archives de Paris - cote 1Fi 1570
Les pompes se trouvent en contrebas de la halle la plus proche du fleuve, tandis que celle située à l’arrière abrite les chaudières.
 © Christian Décamps, Région Île-de-France
© Christian Décamps, Région Île-de-France
Les bâtiments, caractéristiques de l’architecture industrielle de l’époque, sont dotés d’une charpente métallique Polonceau et de façades en moellons de calcaire, tandis que les baies sont entourées d’arcade plein-cintre et de pilastres en briques rouges.
 ©Christian Décamps, Région Île-de-France
©Christian Décamps, Région Île-de-France
Depuis 1974, les bâtiments d’ « Ivry 1 » abritent les réserves du Fonds municipal d’art contemporain de la ville de Paris.
L'îlot le Monde
 ©CAUE 94
©CAUE 94
En préservant la mémoire du lien, un nouvel ensemble urbain dense et conséquent se développe sur ce site.
 Entreprise Le Monde, 1998 © Mairie d’Ivry-sur-Seine
Entreprise Le Monde, 1998 © Mairie d’Ivry-sur-Seine
A cet emplacement, le journal Le Monde annonce en 1989 le lancement de l’imprimerie d’Ivry qui compte jusqu’à 350 salariés. A l’époque chaque éditeur possède son imprimerie, ce choix industriel s’érode dans le temps avec la transformation de la presse et des moyens technologiques. C’est en 2015 que l’imprimerie Le monde ferme ses portes en mutualisant ses moyens de production et de diffusion avec d’autres acteurs.
 ©ANMA Architectes Urbanistes
©ANMA Architectes Urbanistes
Dans le cadre de la ZAC Ivry Confluences, le site accueille aujourd’hui un quartier mixte de 43 000 m² comprenant des logements, une résidence hôtelière, une résidence étudiante, des commerces, des locaux de logistique, des parkings et un jardin d’agriculture urbaine.
L’équipe de concepteurs (ANMA, Nicolas Michelin & Associés, Tolila + Gilliland et Frédéric Lebard) organise ces nouveaux bâtiments autour d’une voie centrale en lien avec le futur parc de la Confluence.
 Structure des anciennes Halles de l’imprimerie le Monde durant le chantier ©ANMA Architectes Urbanistes.
Structure des anciennes Halles de l’imprimerie le Monde durant le chantier ©ANMA Architectes Urbanistes.
Trace historique du passé industriel emblématique d’Ivry-sur-Seine, la structure des deux anciennes halles de l’imprimerie le Monde, est conservée et mise en valeur en cœur d’îlot.
 Structure de l'ancienne imprimerie conservée ©CAUE 94
Structure de l'ancienne imprimerie conservée ©CAUE 94
Cet étonnant squelette en béton est ainsi rendu visible et accessible par tous. Elle coiffe la voie piétonne intérieure qui dessert l’îlot du nord au sud.
Les tours EDF
 ©Martin Argyroglo
©Martin Argyroglo
Architecture inédite, détails constructifs soignés et esthétique sculpturale font de ces tours une architecture remarquable, inscrite en 2003 à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.
 © SIAF, Cité de l’architecture et du patrimoine, Archives d’architecture du XXᵉ siècle Fonds Cardot Joly IFA, 1967
© SIAF, Cité de l’architecture et du patrimoine, Archives d’architecture du XXᵉ siècle Fonds Cardot Joly IFA, 1967
Construits entre 1966 et 1967, ces bâtiments emblématiques de l’Atelier de Montrouge ont été conçus pour loger les cadres du site industriel mitoyen d’EDF.
Afin de s’intégrer au mieux au site urbain et à la présence d’une voie rapide, les architectes de l’Atelier de Montrouge (Jean Renaudie, Pierre Riboulet, Gérard Thurnauer et Jean-Louis Véret) ont choisi de superposer les onze logements et de les répartir au sein de deux petits immeubles de hauteurs égales.
 © SIAF, Cité de l’architecture et du patrimoine, Archives d’architecture du XXᵉ siècle Fonds Atelier de Montrouge
© SIAF, Cité de l’architecture et du patrimoine, Archives d’architecture du XXᵉ siècle Fonds Atelier de Montrouge
Le noyau vertical de circulation est disposé au centre d’un plan carré permettant de libérer des points de vues multiples pour les logements. À chaque étage, le plan des logements pivote d’un quart de tour, permettant ainsi de maximiser l’intimité et la particularité de chaque appartement, mais aussi de créer des variations formelles pour chaque façade.
 © SIAF, Cité de l’architecture et du patrimoine, Archives d’architecture du XXᵉ siècle Fonds Cardot Joly IFA, 1967
© SIAF, Cité de l’architecture et du patrimoine, Archives d’architecture du XXᵉ siècle Fonds Cardot Joly IFA, 1967
La conception moderne, voire brutaliste, s’attache à mettre en valeur les matériaux : le verre, le bois et le béton, laissant apparaître l’empreinte des planches de coffrage.
© CAUE 94
C’est en 2016, dans le cadre de l’opération « Ivry Confluences », que l’aménageur Sadev 94 a confié à Paul Chemetov la réhabilitation du site.
Son intervention respectueuse de l'architecture d'origine a conservé l'âme des bâtiments. Les travaux ont porté sur la reprise de certaines fissures du béton, le nettoyage des façades et le changement des menuiseries.

 © Anne Rizo, photographies 2016
© Anne Rizo, photographies 2016
Paul Chemetov architecte de la réhabilitation ©Adagp Paris 2021
À l’intérieur, les travaux de rénovation ont été accompagnés d’un réaménagement de l’espace : à la demande de l’aménageur, la petite tour a été divisée en deux appartements par niveau, du studio au T3. La seconde tour a gardé sa spécificité avec de grands appartements, notamment en duplex.
 Paul Chemetov architecte de la réhabilitation ©Adagp Paris 2021
Paul Chemetov architecte de la réhabilitation ©Adagp Paris 2021
L'ancienne centrale basse pression
 ©Martin Argyroglo
©Martin Argyroglo
Repère emblématique du passé industriel des bords de Seine, la centrale basse pression d’Ivry-Port est construite à partir de 1923 pour le compte de l’Électricité de la Seine. Elle est destinée à prendre la relève de l’usine du quai de la Rapée pour l’alimentation électrique du métro parisien.
 © Institut géographique national
© Institut géographique national
La centrale, surélevée par rapport au niveau du sol en prévision des possibles crues de la Seine, dispose de deux halles perpendiculaires au fleuve, l’une abritant les chaudières (à gauche) et l’autre les turbo-alternateurs (à droite).
 Extrait du magazine La science et la vie de 1928 © Région Île-de-France
Extrait du magazine La science et la vie de 1928 © Région Île-de-France
Trois passerelles de déchargement sont édifiées au-dessus de la voie publique, pour que les bennes automotrices transportant le charbon nécessaire au fonctionnement en continu de l’usine, puissent circuler.
 Extrait du magazine La science et la vie de 1928 © Région Île-de-France
Extrait du magazine La science et la vie de 1928 © Région Île-de-France
Une coupe de l’édifice permet de se rendre compte des imposants composants de la chaufferie à l’époque de sa construction, mais aussi du mode constructif permettant l’agrandissement potentiel du bâtiment par ajout de travées supplémentaires.
©Christian Décamps, Région Île-de-France
En 1942, la centrale est raccordée au réseau de chauffage et en 1953, elle est complétée par une centrale haute pression, à l’arrière du site.
 © Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France
© Jean-Bernard Vialles, Région Île-de-France
L’activité cesse en 1974, et la chaufferie de la centrale basse pression est reconvertie pour le compte de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU). Les autres bâtiments sont détruits en 1989. La chaufferie conservée et transformée est alors vouée à assurer un appoint en complément du nouveau système de chauffage urbain, alimenté majoritairement par la géothermie profonde.
Le nouveau bâtiment de la centrale géothermique est visible au croisement de la rue Galilée et de la rue des Péniches.
La passerelle industriel Ivry-Chanrenton
© CAUE 94
Dit « Pont aux câbles », ce remarquable édifice, entièrement en béton armé, a été construit en 1930, pour le passage des câbles électriques alimentant la Centrale d’Ivry.
 Extrait du magasine Travaux n° 79,juillet 1939, p. 280 © Région Île-de-France
Extrait du magasine Travaux n° 79,juillet 1939, p. 280 © Région Île-de-France
À sa construction, c’est un record mondial de portée pour les poutres en treillis.
Les deux travées latérales, de portées beaucoup plus faibles que la travée centrale, fonctionnent comme des consoles faisant contrepoids de l’arceau central.
 Extrait du magasine Travaux n° 79,juillet 1939, p. 280 © Région Île-de-France
Extrait du magasine Travaux n° 79,juillet 1939, p. 280 © Région Île-de-France
Les deux appuis aux extrémités de la passerelle sont ainsi traités de manière monumentale afin de former des lests contribuant à l’équilibre de l’ensemble.
Les piles dans la Seine supportent alors la totalité du poids de l’ouvrage, soit un effort vertical de l’ordre de 5 000 tonnes.
Une traversée pour piétons, encore utilisée aujourd’hui, est également prévue dès sa construction.
 Extrait du magasine Travaux n° 79,juillet 1939, p. 280 © Région Île-de-France
Extrait du magasine Travaux n° 79,juillet 1939, p. 280 © Région Île-de-France
Au centre de la passerelle, six compartiments en béton servent de gaines aux groupes de câbles électriques.
La passerelle est encore utilisée aujourd’hui pour le passage d’énergie et d’eau entre Ivry-sur-Seine et Charenton-le-Pont. Trois concessionnaires en ont l’usage :
-La RTE, filiale d’EDF dédiée aux infrastructures de transport d’électricité, est le concessionnaire principal.
-La RATP, pour apporter l’énergie des stations du métro (ligne 8) et du RER A.
-Veolia CGE, pour une canalisation d’eau arrimée au sommet de la passerelle Charenton-Écoles.
l'îlot BHV, du néolithique à nos jours
 Photo de chantier de construction, 2020 © Emmanuelle Colboc & Associés
Photo de chantier de construction, 2020 © Emmanuelle Colboc & Associés
Du Néolithique à ce jour, « l’ilot BHV » a vu se succéder différentes phases d’occupation. Révélé comme une site clé dans l’étude du Néolithique moyen, l’industrie prendra peu à peu la place de ces terres agricoles à la fin du XIXᵉ siècle, puis en 2008, le projet de la ZAC Ivry Confluences y redessine un nouvel environnement urbain.
 Vue aérienne sur le quartier d'Ivry-Port : entrepôt du BHV © Archives municipales d'Ivry-sur-Seine.
Vue aérienne sur le quartier d'Ivry-Port : entrepôt du BHV © Archives municipales d'Ivry-sur-Seine.
En 1926, le bazar de l'Hôtel de ville (BHV) installe ses entrepôts dans des bâtiments autrefois propriétés de la compagnie française de Matériel de Chemin de Fer. Fondée en 1872, celle-ci fabriquait des wagons appelés « motrices Ivry ».
Après leur destruction durant la Seconde Guerre mondiale, ceux-ci sont reconstruits dans les années 1960. Les locaux n’étant plus adaptés, le groupe BHV déménage en 2008. Le site est mis en vente, et la ville préempte les 5 hectares pour le projet « ZAC Ivry Confluences ».
 Carte des fouilles archéologiques sur le site Ivry Confluence © Inrap
Carte des fouilles archéologiques sur le site Ivry Confluence © Inrap
Depuis 2014, avant d’entamer les travaux pour la ZAC Ivry Confluences, les archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et du Conseil départemental du Val-de-Marne effectuent des chantiers de fouilles.
 Habitations matérialisées par la présence de trous de poteau et de vestige retrouvés sur le sol d’habitations © Denis Gliksman, Inrap
Habitations matérialisées par la présence de trous de poteau et de vestige retrouvés sur le sol d’habitations © Denis Gliksman, Inrap
Les recherches permettent de découvrir l’évolution du paysage de la confluence Seine / Marne et de comprendre la succession d’occupations humaines. Les fouilles ont mis à jour des habitations datant du néolithique et du bronze ancien.
 © CAUE 94
© CAUE 94
En 2021, trois programmes de constructions requalifient l’ancien îlot BHV pensé par l’agence d’architecture Emmanuelle Colboc & Associé. Un gymnase, un groupe scolaire et une résidence étudiante sont érigés près de la place Gambetta. Ils forment, avec la place du marché et le futur parc Ivry Confluence, une nouvelle séquence urbaine.
L'ancien bâtiment de la chaufferie et sa cheminée sont quand à eux conservés et réhabilités.
La ZAC Ivry Confluences

Situé entre le faisceau ferroviaire et la confluence de la Seine et de la Marne, ce vaste projet urbain et paysager représente un pôle stratégique de développement métropolitain de près de 145 hectares.
 Périmètre opérationnel de la ZAC Ivry Confluences © uapS + ACLAA + BASE + Zefco + WT2i
Périmètre opérationnel de la ZAC Ivry Confluences © uapS + ACLAA + BASE + Zefco + WT2i
Confié à la Sadev 94, son aménagement prévoit près d’un million de mètres carrés répartis entre immobilier d’entreprise et projets résidentiels, de nombreux équipements publics, la création de squares, de mails récréatifs et d’un vaste parc en bord de Seine. Un nouveau groupement de maîtrise d’œuvre mené par l’agence uapS poursuit depuis 2019 la conduite de la ZAC Ivry Confluences.
 © uapS + ACLAA + BASE + Zefco + WT2i
© uapS + ACLAA + BASE + Zefco + WT2i
Le projet comporte une forte dimension environnementale, avec un retour de la nature en ville et le développement d’un vaste réseau de chaleur alimenté par géothermie. Le futur T-Zen 5, réseau de bus à haut niveau de service en site propre, reliera prochainement la bibliothèque nationale François Mitterrand au cœur du quartier afin de renforcer le désenclavement du secteur. A plus long terme est également prévu le prolongement de la ligne 10 du métro jusqu’à la place Gambetta.
 Vue sur les anciennes emprises industrielles du Monde et de Total, en cours de requalification, vers 2020 © CAUE94
Vue sur les anciennes emprises industrielles du Monde et de Total, en cours de requalification, vers 2020 © CAUE94
Depuis le démarrage de l’opération, plus de 3 000 logements ont été programmés dont plus de la moitié a déjà été livrée. 4 000 emplois sont en cours de développement dans des bâtiments neufs, majoritairement tertiaires, à proximité des stations de Tzen 5 et du RER C. En outre, la réhabilitation de bâtiments industriels se poursuit, d’une part pour relocaliser les activités implantées sur des emprises mutables, d’autre part pour accueillir de nouvelles entreprises, souvent issues de filières créatives.
L'ancienne usine SKF
 © CAUE 94
© CAUE 94
Fondée en 1904, l’usine de Roulement à Bille Française RBF puis SKF s’étendait sur un site de 4,5 hectares.
Le 31 décembre 1943, le site est visé par un bombardement américain et une bonne partie des entrepôts de fabrication sont détruits.
Dans les années 1960, l’usine emploie encore 2000 ouvriers.
 © Archives municipales d’Ivry-sur-Seine
© Archives municipales d’Ivry-sur-Seine
Elle ferme ses portes au milieu des années 1980 après un conflit social de plus de deux ans qui a marqué durablement l'histoire du Département.
Une partie des bâtiments subsistent encore le long de la rue Maurice Gunsbourg.
Les autres bâtiments seront détruits, notamment pour permettre la construction des imprimeries du journal Le Monde en 1987.
 © Archives municipales d’Ivry-sur-Seine
© Archives municipales d’Ivry-sur-Seine
L’ ancienne « usine des lampes »
 © CAUE 94
© CAUE 94
La Cheminée de l’ancienne usine à gaz de la Compagnie des Lampes constitue aujourd’hui un élément symbolique conservé en témoignage du passé industriel du site.
 Entrée de l’usine de la Compagnie générale d’électricité ©Christian Décamps, Région Île-de-France
Entrée de l’usine de la Compagnie générale d’électricité ©Christian Décamps, Région Île-de-France
Usine emblématique de l’histoire industrielle d’Ivry-sur-Seine, la Compagnie des Lampes, dédiée à la production d’ampoules électriques et construite en 1888, connaît de multiples transformations jusqu’en 2008.
 © Archives municipales d’Ivry-sur-Seine
© Archives municipales d’Ivry-sur-Seine
À sa construction, le site comprend trois grandes halles métalliques accolées ainsi qu’un modeste pavillon contenant des bureaux. A l’autre extrémité se trouve l’usine à gaz ainsi que des magasins.
En 1898, la Compagnie des lampes est absorbée par la Compagnie générale d’électricité. Cette dernière développe son activité en construisant sept bâtiments supplémentaires en pierre meulière, aux fonctions distinctes.
 Futur bâtiment pour l’appareillage électrique, 6 juin 1902 ©Christian Décamps, Région Île-de-France
Futur bâtiment pour l’appareillage électrique, 6 juin 1902 ©Christian Décamps, Région Île-de-France
En 1902, certains bâtiments, pourtant récents, se révèlent être déjà obsolètes alors que de nouveau bâtiments viennent s’ajouter car l’usine ne cesse de croître.
En 1907, une crèche pour les enfants d’ouvrières est construite, celle-ci affirme une architecture « hygiéniste », préoccupation naissante à cette époque.
 © Archives municipales d’Ivry-sur-Seine
© Archives municipales d’Ivry-sur-Seine
Certains bâtiments sont constitués de remarquables façades en meulière et en briques agrémentés de frises polychromes. D’autres se distinguent par une construction métallique en hauteur avec une toiture en shed permettant un éclairage zénithal jusqu’au rez-de -chaussée.
 Maquette de l’usine © Stéphane Asseline, reproduction, Région Île-de-France
Maquette de l’usine © Stéphane Asseline, reproduction, Région Île-de-France
En 1914, la compagnie s’étend sur 5 hectares et ne cessent d’évoluer :
- 1921 : Création de la Compagnie des lampes dû à la fusion du département des lampes et de Thomson Houston.
- 1931 : Le groupe Philips s’associe à la compagnie, et donne naissance aux fabriques de lampes électriques.
- 1982 : Thomson cède ses parts à Philips.
- 1983 : Philips installe une filiale sur le site d’Ivry-sur-Seine.
- 1995 : Philips installe le siège social de Philips éclairage sur le site d’Ivry-sur-Seine.
- En 2008, Philips quitte définitivement le site d’Ivry-sur-Seine.
La plupart des bâtiments sont rasés et accueille une nouvelle voie, des logements ainsi qu’un collège
L'ancienne usine de matelas
 © CAUE 94
© CAUE 94
L’ancienne fabrique de matelas Léon Bauve, fondée en 1895 et approvisionnant un magasin parisien, est toujours visible aujourd’hui.
 Couverture du catalogue commercial de l’entreprise Léon Bauve © Archives municipale d’Ivry-sur-Seine
Couverture du catalogue commercial de l’entreprise Léon Bauve © Archives municipale d’Ivry-sur-Seine
L’usine, reconstruite après la première guerre mondiale en 1931, témoigne du renouveau de l’architecture industrielle de l’époque.
 Intérieur de l'usine © Christian Décamps, Région Île-de-France
Intérieur de l'usine © Christian Décamps, Région Île-de-France
Grâce à la finesse désormais possible des montants en petits fers, les châssis vitrées se perfectionnent et permettent d’agrandir et de varier les formes des ouvertures.
© Christian Décamps, Région Île-de-France
 Coupe du projet de reconstruction de l’usine déposé en 1911 © Stéphane Asseline, reproduction, Région Île-de-France
Coupe du projet de reconstruction de l’usine déposé en 1911 © Stéphane Asseline, reproduction, Région Île-de-France
Le site comprenait un magasin industriel, des ateliers de confection et une conciergerie.
Cette usine se distingue par la composition du bâtiment principal, qui se déploie élégamment en trois vaisseaux.
Constitué d’un assemblage de fermes métalliques « à la Polonceau », le système porteur de ce bâtiment, permet de créer de longues ouvertures en toiture.
 Détail des profils rivetés et boulonnés caractéristiques de l'architecture métallique de cette époque © Christian Décamps, Région Île-de-France
Détail des profils rivetés et boulonnés caractéristiques de l'architecture métallique de cette époque © Christian Décamps, Région Île-de-France
L’Ancienne usine de traitement des eaux
 ©Martin Argyroglo
©Martin Argyroglo
Plusieurs usines, propriétés du département de la Seine puis de la ville de Paris, ont été successivement construites à Ivry pour alimenter en eau la capitale.
 ©Photographie SADEV 94-Annotation CAUE 94.
©Photographie SADEV 94-Annotation CAUE 94.
La première usine dénommée « Ivry 1 », réalisée en 1883 et visible en amont du parcours, est complétée en 1899 par deux bâtiments également implantés sur les quais de la Seine.
Pour répondre aux nouvelles obligations, les installations sont plusieurs fois agrandies et modernisés et « Ivry 2 » sera complétée par 16 bassins filtrants d’une superficie de 14 000 m² et une usine élévatoire entièrement électrique : « Ivry 3 ».
 © Archives municipales d’Ivry-sur-Seine
© Archives municipales d’Ivry-sur-Seine
En 1958, se déployant sur 5,6 hectares, l’établissement produit chaque jour entre 350 000 et 400 000 m³ d’eau pour une surface totale de bassins filtrants de 45 800 m².
Les machines à vapeur sont remplacées par deux générations successives de groupes de pompage électrique, en 1928 puis en 1950, tandis que les principes de filtration sont perfectionnés.
Malgré cela, en 1987, il est décidé de reconstruire l’usine vieillissante.
 © Michel Denancé / Dominique Perrault Architecte / ADAGP
© Michel Denancé / Dominique Perrault Architecte / ADAGP
La SAGEP (Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris) confie donc à l’architecte Dominique Perrault la construction d’une nouvelle usine, sur l’emplacement des anciens bassins. Elle ouvre ses portes en 1994.
Le centre de traitement comprend un bâtiment futuriste de 250 mètres de long par 50 mètres de large relié par une galerie oblique à un immeuble de bureaux qui abrite poste de commande, laboratoires et ateliers.
 © Michel Denancé / Dominique Perrault Architecte / ADAGP
© Michel Denancé / Dominique Perrault Architecte / ADAGP
Projet emblématique, vitrine technologique et pédagogique, la nef, entourée d’une galerie cylindrique horizontale qui s’ouvre sur son environnement, marie élégamment béton, verre et métal, évoquant la transparence et les reflets de l’eau.
Paris consommant de moins en moins d’eau, l’usine de traitement cesse son activité en 2009, l’eau prélevée étant de moins bonne qualité que dans les deux autres centres de traitement situés à Joinville-le-Pont et Orly.
Le laboratoire et un surpresseur sont cependant toujours en fonctionnement.
 Le centre d’hébergement d’urgence d’EMMAÜS réalisé par l’Atelier Rita © David Boureau
Le centre d’hébergement d’urgence d’EMMAÜS réalisé par l’Atelier Rita © David Boureau
En attendant un nouvel avenir, en 2017 les villes de Paris et d’Ivry-sur-Seine mettent temporairement à disposition une partie du site pour la construction d’un centre d’hébergement d’urgence EMMAÜS Solidarité. Œuvre de l’Atelier Rita, cet ensemble bâti entièrement démontable et réutilisable, posé sur des piles de bétons pour répondre au PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation), est conçu comme un fragment de ville installé au-dessus des bassins filtrants asséchés.
 Le projet Manufacture-sur-Seine, lauréat du concours Réinventer la Seine © Amateur architecture studio, Joly Loiret architectes, Lipsky+Rollet architectes.
Le projet Manufacture-sur-Seine, lauréat du concours Réinventer la Seine © Amateur architecture studio, Joly Loiret architectes, Lipsky+Rollet architectes.
La même année, les agences Amateur Architecture Studio, Lipsky+Rollet architectes et Joly-Loiret architecte, lauréates du concours Réinventer la Seine, proposent de nouvelles perspectives pour l’ancien site industriel. D’une part, "le village", un ensemble de logements en terre crue et ossatures béton et bois est envisagé sur la trame des anciens bassins devenus espaces verts. D’autre part, "le Ruban", une architecture-paysage en structure bois dédiée à différents usages, vient coiffer l’ancienne nef réhabilitée.
Le groupe scolaire Rosalind Franklin
 ©Martin Argyroglo
©Martin Argyroglo
Livré en 2015 parmi les premiers bâtiments de la ZAC Ivry Confluences, ce projet de l’agence d’architecture Chartier Dalix imbrique subtilement un groupe scolaire maternelle-primaire et une résidence étudiante.
 ©Chartier Dalix
©Chartier Dalix
L’école s’organise sous la forme d’un paysage en terrasses végétalisées successives.
Des plantes grimpantes se développent sur les auvents métalliques qui prolongent les acrotères des terrasses plantées. Au rez-de-chaussée, d’autres auvents suivent le souple contour des classes, unissant ainsi les espaces intérieurs et extérieurs.
 ©Chartier Dalix
©Chartier Dalix
Ce choix spatial résulte d’une volonté d’offrir à l’usager différentes perceptions de son propre bâtiment, mais aussi d’un environnement plus étendu, du cœur d’îlot jusqu’au quartier.
Ce principe d’ouverture et de transparence se retrouve dans le traitement des façades, majoritairement constituées de vitrages toute hauteur ou de remplissages en verre trempé. Des stores extérieurs permettent de se protéger d’un soleil trop fort et d’occulter les classes si besoin.
 ©Chartier Dalix
©Chartier Dalix
Au premier étage, la terrasse accessible depuis les espaces communs est agrémentée de grands bacs pour y cultiver plantes aromatiques et légumes, et sert de jardin pédagogique.
 ©Chartier Dalix
©Chartier Dalix
À l’angle nord-est de la parcelle, la résidence étudiante de neuf étages sur un rez-de-chaussée commercial protège l’école des nuisances de l’avenue sans lui porter ombrage. Derrière une façade légère, composée de panneaux métalliques perforés tantôt fixes tantôt coulissants, des balcons filants servent de prolongements extérieurs aux pièces de vie des studios. Les logements profitent là d’un ensoleillement maximum et d’une vue exceptionnellement dégagée.
Logements contemporains rue Ampère
Au 29-35 de la rue Ampère
L’immeuble de 61 logements réalisé par Atelier du Pont constitue un ensemble homogène et élégant rythmé par une succession de volumes, alternant façades de briques noires et enduit blanc.
 ©Takuji Shimmura
©Takuji Shimmura
Situés en zone inondable, les logements sont surélevés. On y accède par des passerelles qui traversent, dans la frondaison des arbres, un jardin en pleine terre.
 ©Takuji Shimmura
©Takuji Shimmura
Supplément artistique, l'Atelier YokYok a réalisé une anamorphose sur les porches, établissant un dialogue graphique et ludique avec le groupe scolaire qui lui fait face.
Au 37-45 de la rue Ampère
La résidence de 91 logements conçue par l’agence Charles Henri Tachon forme une architecture dynamique où les nuances chaudes de la brique se mêlent aux tonalités mordorées des menuiseries et des garde-corps.
 ©Kirsten Pelou
©Kirsten Pelou
L’ensemble est composée de deux corps de bâtiments organisés autour d’un jardin central.
Les hauteurs de chaque immeuble redescendent le long de la ruelle piétonne afin de limiter l’ombre portée sur l’école et l’espace public voisins.
À l’angle des rues Ampère et Nouvelle
Un immeuble de 51 logements, conçu par Thibaud Babled, développe une façade monolithe de briques brunes scandée par de fines structures de béton blanc formant loggias et balcons.
 ©Thibaud Babled architectes urbanistes
©Thibaud Babled architectes urbanistes
La compacité du bâtiment sur rue permet de libérer de généreux espaces plantés en fond de parcelle, à distance de l’espace public.
 ©Thibaud Babled architectes urbanistes
©Thibaud Babled architectes urbanistes
Le socle de l’édifice se profile à l’alignement des deux voies, dessinant ainsi le prolongement de la rue Ampère. Les façades des étages supérieurs, quant à elles, reculent progressivement des limites viaires pour dessiner une continuité volumétrique avec la résidence voisine.
L'ancien laboratoire Ampère
© CAUE 94
Haut lieu d’expérimentation scientifique, ce bâtiment abritait dès 1930 les travaux sur la synthèse atomique de Pierre Joliot et Irène Curie, prix Nobel en 1935.
 Laboratoire de synthèse atomique CNRS (rue Maurice Gunsbourg) : générateur de chocs de 3 millions de volts. 1963 © Archives municipales d’Ivry-sur-Seine.
Laboratoire de synthèse atomique CNRS (rue Maurice Gunsbourg) : générateur de chocs de 3 millions de volts. 1963 © Archives municipales d’Ivry-sur-Seine.
En 1930 le CNRS acquiert le laboratoire d’essai de la Compagnie Générale d’Électro-céramique et plus particulièrement le « générateur à impulsions », surnommé « l’éclateur ». Ancêtre des premiers accélérateurs de particules français, cette machine, la plus puissante au monde pour l’époque est capable de reproduire la foudre.
Imposante, elle mesure 12 mètres de hauteur et a permis de nombreuses expérimentations en physique nucléaire.
C’est grâce à celle-ci, par exemple, que les Joliot Curie ont fait leurs expérimentations sur la synthèse de radioéléments artificiels, qui ont par la suite remplacé les radiums dans le traitement du cancer.
Laboratoire de synthèse atomique : éclateur avant son transfert © Archives municipales d’Ivry-sur-Seine.
Lors de l’exposition universelle de 1937 à Paris, cette machine est au cœur de toutes les attentions. De nombreux savants utilisent le générateur d’impulsions jusqu’à sa vente. Sauvé de la casse par le musée EDF-Electropolis de Mulhouse, et classé monument historique, « l’éclateur » est restitué à la ville d’Ivry-sur-Seine en 2005. Cette même année, le musée des Arts et Métiers présente une exposition des clichés de Robert Doisneau immortalisant le laboratoire Ampère entre 1930 et 1950.
Successivement laboratoire de synthèse atomique, et d’optique protonique, centre de cytologie expérimentale et enfin centre de biologie cellulaire, le site ferme ses portes dans les années 1990. Ce lieu iconique est transformé en un lieu d’expérimentation d’art contemporain par le sculpteur et architecte d’intérieur Francesco Passaniti : le site devient la Galerie RX en 2010. Le générateur scientifique devient alors le « générateur » artistique.
Les anciens abattoirs
Ivry-sur-Seine abrite également de nombreux sites liés à l’industrie alimentaire. En témoigne notamment les bâtiments des anciens abattoirs encore visibles rue Pierre Rigaud.
 ©Christian Décamps, Région Île-de-France
©Christian Décamps, Région Île-de-France
En 1900, une première halle, aujourd’hui détruite, abrite le hall d’abattages et le brûloir. La seconde, encore en place, contient à l’époque, les marchés.
 ©Christian Décamps, Région Île-de-France
©Christian Décamps, Région Île-de-France
Le deux bâtiments latéraux hébergent, quant à eux, des étables, des bergeries des abreuvoirs, des échaudoirs, des triperies, des cases à veaux et à porcs, une salle de découpage, une chambre aérothermique, et un chenil.
 ©Les Archives départementales
©Les Archives départementales
À l’origine, le site comprenait également deux pavillons d’entrée sur la place de l’Insurrection, aujourd’hui détruits. Un foyer municipal de retraités est construits à leur emplacement en 1980.
 © Stéphane Asseline, reproduction, Région Île-de-France
© Stéphane Asseline, reproduction, Région Île-de-France
Construits par l’architecte Jules Guillemin, dont les initiales sont visibles sur les briques qui ornent l’édifice, les différents bâtiments constituants les abattoirs, sont construits en pierre de meulière et vêtus de tuile plate et les deux grandes halles se composent d’une charpente métallique.
Aujourd’hui, le site accueillent les services municipaux de la voirie de la ville d’Ivry.
La Minoterie
 ©Martin Argyroglo
©Martin Argyroglo
Usine à l’architecture soignée, la minoterie Delangle, construite à partir de 1899, est un ensemble singulier et remarquable, vestige du passé industriel d’Ivry-sur-Seine.
 Minoterie Delangle en 1988 © C. Décamps. Région Île-de-France.
Minoterie Delangle en 1988 © C. Décamps. Région Île-de-France.
Le site de 5 000 m² comprend l’usine, implantée en fond de parcelle, une halle destinée au stockage des réserves et le pavillon du directeur, situé sur le boulevard, dont les plans sont signés Auguste Labussière, ingénieur-architecte parisien.
 Plan du pavillon du directeur de la minoterie, boulevard Sadi Carnot, années 1920 © Archives municipales d'Ivry-sur-Seine.
Plan du pavillon du directeur de la minoterie, boulevard Sadi Carnot, années 1920 © Archives municipales d'Ivry-sur-Seine.
L’entreprise familiale est reprise en 1955 et agrandie par les établissements Molinari, grossistes en produits alimentaires, jusqu’à cessation de leur activité à la fin des années 1980.
Le cœur d’îlot de la Minoterie © Sébastien Héry architectes
À partir de 2017, le site fait l’objet d’un projet de requalification. L’architecte Sébastien Héry, en charge d’une partie du projet, réhabilite et valorise les bâtiments existants construits en pierre meulière, ornés de décors en céramique et de briques polychromes.
Dialogue de volumes et de matières entre bâtiment existant et extension contemporaine © Sébastien Héry architectes
Le projet recrée un lieu de vie mixte comprenant des logements, des espaces de travail et un restaurant associatif.
Des extensions contemporaines, pensées en résonnance avec l’ensemble patrimonial, sont implantées au sud de la maison et dans la prolongation de la halle jusqu’au boulevard.
 © Hervé Abbadie photographe. Valero Gadan architectes & associés
© Hervé Abbadie photographe. Valero Gadan architectes & associés
Au voisinage immédiat, l’agence d’architecture Valero Gadan & associés a livré en 2021 un immeuble de sept étages comprenant une centaine de logements et des commerces. Pensée comme une double peau, la trame du bâtiment génère des creux pour scander le linéaire de façade et offrir de grands espaces extérieurs aux logements. En cœur d’îlot, un jardin est visible par un porche d’accès.
La cité de l'insurrection
 ©Martin Argyroglo
©Martin Argyroglo
Immeuble de logements sociaux de type Habitation à bon marché (HBM), la Cité de l’Insurrection est un ensemble à l’architecture remarquable ornée de motifs décoratifs alternant briques jaunes et rouges et grès bleu.
 La cité Philibert Pompée et la boulangerie La Fraternelle, à l'angle des rues Bourgeois (auj. Edme Guilloux) et Jean-Jacques Rousseau, 1939 © Archives municipales d’Ivry-sur-Seine
La cité Philibert Pompée et la boulangerie La Fraternelle, à l'angle des rues Bourgeois (auj. Edme Guilloux) et Jean-Jacques Rousseau, 1939 © Archives municipales d’Ivry-sur-Seine
Inaugurée en 1927 sous le nom de « Cité Philibert Pompée », cette architecture monumentale de six étages, conçu par Henri et Robert Chevallier, est articulée autour de deux cours semi-ouvertes sur les rues alentour. Elle doit loger à un tarif abordable la main-d’œuvre modeste qui, attirée par le développement de l’activité industrielle d’Ivry, arrive en masse et vit de façon précaire dans des meublés ou les logements insalubres de la commune.
 © Archives municipales d'Ivry-sur-Seine, Studio Chevojon.
© Archives municipales d'Ivry-sur-Seine, Studio Chevojon.
Entre 1928 et 1929, les premiers locataires emménagent dans les 290 logements d’un niveau de confort rare pour l’époque : chauffage central, WC individuels, ballon d’eau chaude, système de ventilation et d’évacuation des ordures, etc. Les habitants profitent aussi des équipements de la cité (douche collective, salle de réunion, lavoir municipal), ainsi que de 12 ateliers d’artisans et de 11 boutiques.
 Jeunes militants communistes de la cité lors d'une vente du journal L'Avant-Garde, 1953 © Archives municipales d’Ivry-sur-Seine, Fonds privé
Jeunes militants communistes de la cité lors d'une vente du journal L'Avant-Garde, 1953 © Archives municipales d’Ivry-sur-Seine, Fonds privé
Dans les années suivantes, une vie collective et une solidarité importante se développent dans la Cité Philibert Pompée. Les locataires se regroupent pour défendre leurs intérêts et animer leur quartier.
Les habitants partagent également leurs loisirs à travers la chorale et la troupe de théâtre amateur de la cité, et l’organisation de deux fêtes annuelles, au printemps et en fin d’année.
 Façades de la Cité de l’Insurrection aujourd’hui ©Martin Argyroglo
Façades de la Cité de l’Insurrection aujourd’hui ©Martin Argyroglo
Après la libération du joug allemand en août 1944, la Cité Philibert Pompée est rebaptisée « Cité de l’Insurrection ».
Réhabilitée en 1993, elle accueille aujourd’hui 200 logements sociaux gérés par l’Office Public de l’Habitat d’Ivry. Les boutiques et équipements collectifs originels ont en revanche disparus.